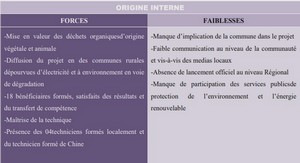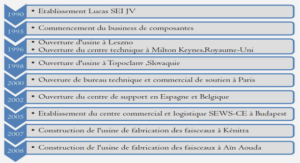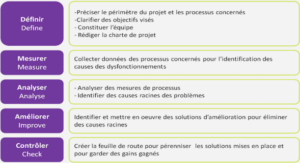reud relu par Laca
Cette idée que le langage obéirait, en dernière analyse, à un centre de gravité unique, à un code, la langue, conçu comme une infrastructure, apparaît donc bien comme une réduction positiviste qui écrase, au profit d’un système souvent binaire, la complexité des phénomènes. Christian Metz a bien perçu cet appauvrissement, dans Le Signifiant imaginaire, où il interroge la théorie rhétorique, linguistique et psychanalytique à propos de la métaphore, et regrette l’abandon du couple paradigme / syntagme, qui « perd de sa force » en psychanalyse mais qui aurait permis des éclaircissements bienvenus. Il conclut à ce propos au « non recouvrement de catégories venues d’horizons divers (linguistique, rhétorique, psychanalyse) ».130 Si nous ne pouvons que souscrire, dans les grandes lignes, à son propos, et en particulier à ce constat – qui est formulé à plusieurs reprises – il convient de souligner précisément la responsabilité de Lacan quant à cette confusion, qui n’apparaît pas toujours nettement dans l’ouvrage, dont le titre avoue même un reste d’allégeance. Il en va de même, d’ailleurs, pour la plupart des auteurs structuralistes et néo-rhétoriciens cités par Christian Metz, qui ont bel et bien continué à brouiller les cartes, à superposer des couples de notions incompatibles, même s’ils ont pu sentir que les notions ne « s’alignaient » pas, ou avoir des remords, et corriger en partie leur propos. C’est le cas de Lacan lui-même, qui reprend la réflexion où Jakobson l’a laissée à la fin de l’article « Deux aspects du langage et deux types d’aphasies », où le linguiste esquissait un rapprochement avec les notions freudiennes de condensation et de déplacement : alors qu’il éprouve des réticences perceptibles face au modèle linguistique, il ne conteste pas frontalement le modèle jakobsonnien, c’est le moins que l’on puisse dire, et il ajoute même à celui-ci d’autres couples de notions, d’origine nettement psychanalytique, dont les deux premiers procédés à l’œuvre dans le travail de transformation du rêve, confortant ainsi le modèle binaire initial, même pour ceux qui n’auraient pas été convaincus – et Lacan sembler indiquer luimême, au cours de son séminaire du 9 mai 1956, qu’il y en a au sein de son public.131 Malgré la complexité du propos lacanien, malgré son style volontiers déroutant, de toute évidence à dessein, il faut donc se pencher sur cette psychanalyse structuraliste, qui vaut mieux que le mépris désinvolte où il est facile de la tenir, mais qui n’en agace pas moins, assez souvent, comme on devine que ce fut le cas pour Ricœur, qui se résolut à ne pas parler de Lacan dans son ouvrage sur Freud, faute d’avoir pu le comprendre.132 Aussi éviterai-je de taxer de « délire », comme le fait Nanine Charbonnel à la suite de François Roustang, la prose d’un auteur fertile en associations pour le moins hasardeuses.133 Il ne s’agit pas pour moi de contester cette appréciation : que le « délire » en question ait été largement partagé ne saurait constituer une objection et le délire n’empêche pas le raisonnement de présenter une certaine rigueur ou d’excellentes intuitions. Mais, si l’on veut expliquer pourquoi des auteurs si nombreux, parfois même critiques à l’endroit de Lacan, et dans tous les cas rarement perçus comme délirants, à l’instar du groupe µ, de Genette ou de Pierre Legendre, ont pu s’approprier des conceptions trouvées chez lui ou confortées par lui, être inspirés par certaines de ses intuitions, il faut entrer dans le détail de cette équivoque relevée à juste titre par François Roustang.
Du syntagme au paradigme
A la recherche du système perdu Ce qui frappe en effet, dans la théorie de la métaphore proposée par Jacques Lacan, c’est l’extrême diversité des sources auxquelles il puise. Sans même évoquer les sources anthropologiques ou l’inspiration philosophique (Hegel, Marx, Heidegger), le croisement des influences est impressionnant : aux références rhétoriques et linguistiques toujours mentionnées, qui viennent donc se greffer tant bien que mal sur des notions psychanalytiques, il ne faudrait pas omettre l’influence surréaliste, de toute évidence déterminante. Mais, au sein même de ces domaines, des chemins de traverse apparaissent encore, des bifurcations inattendues, qui mettent en danger tout l’édifice. Le problème n’est pas que le psychanalyste fasse subir une énorme torsion aux concepts de Ferdinand de Saussure, par exemple, comme le suggère Nanine Charbonnel, présupposant par là que Saussure aurait raison contre Lacan ou Jakobson, mais bien plutôt que les concepts forgés n’ont, en réalité, aucune consistance véritable, aucune stabilité. Ce ne sont pas non plus, pas vraiment, des « coques creuses », dans la mesure où chaque affirmation est soutenue par une intuition, assez juste en général d’ailleurs, souvent intéressante : le problème, c’est que rien ne signale que le concept de la page suivante, qui porte le même nom que celui de la page précédente, a changé. Aussi, en assumant un certain jeu sur les mots, conçu notamment comme un jeu avec les lecteurs, une forme d’humour, et en assumant par ailleurs un certain hermétisme, privilégiant ainsi la « porte étroite » du discours, Lacan prend-il le risque de tomber lui-même dans le piège qu’il tend à ses détracteurs, celui de perdre le fil d’un raisonnement sous-jacent qui serait, lui, parfaitement tendu.135 Dans cette écriture « entre les lignes », on devine en particulier une stratégie délibérée de pousser le lecteur, en permanence, à rechercher la pertinence de ses affirmations, l’esprit derrière la lettre du discours, pour maintenir la réflexion à son plus haut niveau, pour que la pensée soit vive, qu’elle procède toujours d’une expérience vivante. Mais, derrière l’intention louable, on perçoit également des profits moins avouables, qui recoupent les observations de François Roustang dans Lacan, de l’équivoque à l’impasse : celui de s’épargner en retour l’exigence d’une rigueur accrue et constante, ou de profiter des effets de l’équivoque, en permettant au lecteur de collaborer au-delà du raisonnable à l’établissement du sens. Qu’en est-il, donc, concernant la métaphore ? Avant d’étudier ses rapports avec la théorie du « signifiant », très vaguement inspirée de Saussure, et plus largement avec celle de l’inconscient « structuré comme un langage », il faut noter ce fait que l’usage des notions de syntagme et de paradigme, pour aborder la figure de style, est assez particulier. Nous savons en effet que Lacan forge ses concepts de métaphore et de métonymie sur une référence appuyée à Jakobson, à son article sur les aphasies, aussi bien dans les cours du 2 et 9 mai 1956 qui sont consacrés aux deux figures que dans l’intervention de 1957 publiée sous le nom de « L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la raison depuis Freud ».136 Or, cette assimilation même du couple métonymie métaphore aux mécanismes de contiguïté / similarité ne se pose pas vraiment de la même façon chez Lacan que chez le linguiste, même si celui-ci inspire une énorme partie des développements. C’est dans le séminaire de 1956 que cela apparaît le plus nettement. On peut d’ailleurs noter la façon dont cette réflexion sur les figures s’inscrit dans la question des psychoses, qui faisait l’objet du séminaire cette année-là, même si l’articulation n’est pas beaucoup soulignée. L’indication donnée par Lacan est d’un grand intérêt pour nous : à la lecture d’une série de « textes qui se répètent » d’un psychotique, le président Schreber (textes qu’il ne juge pas utile de livrer), le psychanalyste se dit frappé par le constat qu’« on n’y rencontre jamais rien qui ressemble à une métaphore. » Il s’agit pour Lacan de montrer que la métaphore constitue une dimension essentielle du symbolique, cette fonction entravée, selon lui, dans les psychoses. Suit alors une tentative de définition de la figure, présentée comme nécessairement impliquée par le style poétique : très intéressante, elle n’est pas déterminée par la seule idée de substitution, elle est même tournée vers l’idée de prédication. Seulement, elle débute par un exemple devenu fameux, le vers suivant de Victor Hugo, extrait de « Booz endormi » : « Sa gerbe n’était point avare ni haineuse ». Aussi Lacan est-il partiellement fondé à noter qu’il n’y a pas là de « comparaison latente » : la figure déborde de beaucoup le parallélisme proposé. Il ne faut pas comprendre, en effet – ou plutôt il ne faut pas comprendre seulement – « de même que la gerbe s’éparpillait volontiers entre les nécessiteux, de même notre personnage n’était point avare, ni haineux. » Et Lacan de conclure : « Il n’y a pas là comparaison, mais identification. » 137 Du danger, une nouvelle fois illustré, de théoriser sur un échantillon trop réduit : comme cela a été maintes fois souligné, la « métaphore » de Hugo est aussi, et même avant tout, une métonymie. C’est ainsi que Lacan peut tirer la métaphore du côté de l’identification : qu’il y ait une « identification » entre la « gerbe » qui s’abandonne et Booz endormi, qui d’habitude donne volontiers des épis aux pauvres, ne pose pourtant pas problème, mais l’évidence que Lacan croit tirer de son exemple lui vient précisément d’une évacuation trop rapide de la « comparaison » et, s’il peut se permettre cette évacuation-là, s’il croit pouvoir déceler une « identification » sans comparaison, c’est que l’identification repose en large partie sur un « glissement » du propriétaire à son bien, le blé. Il ne considère dans un premier temps que le travail de nomination, la simple substitution de « gerbe » à « Booz », comme si Hugo avait voulu se contenter de stupéfier le lecteur par une association inhabituelle, la clef étant fournie par les deux vers suivants (les vers 11 et 12) : « Quand il voyait passer quelque pauvre glaneuse / – Laissez tomber exprès des épis, disait-il. ». On devine d’ailleurs que l’idée est venue à Hugo par le vers précédent (le vers 9), comparant sa barbe à la nature, même si ce n’est pas à un champ ou à une prairie fleurie mais à un ruisseau argenté. C’est donc à ce prix, en mettant entre parenthèses le parallélisme, que Lacan introduit la notion de métaphore. Il n’en reste pas là, cependant. Il a même conscience de la réduction : « l’usage que nous faisons du terme de symbolique nous amène en fait à en réduire le sens ». Hélas, pour dénoncer celle-ci, qu’il perçoit dans son analyse de « Booz endormi », il précise qu’il ne faut pas se contenter de « désigner la seule dimension métaphorique du symbole » (je souligne). Néanmoins, pour évoquer « l’articulation prédicative », la syntaxe de la phrase hugolienne, il ne fait pas encore intervenir la métonymie : il se contente de souligner qu’on ne peut s’arrêter à l’ordre signifiant du dictionnaire, qu’il existe un usage de la langue « où la signification arrache le signifiant à ses connexions lexicales ». Pour décrire le phénomène de la métaphore vive, il souligne qu’on ne peut se passer de « la distance maintenue entre le sujet et ses attributs », ajoutant qu’« il est tout à fait exclu qu’un animal fasse une métaphore » : n’ayant pas accès au discursif, « la métaphore est impensable dans la psychologie animale de l’attraction, de l’appétit, et du désir. »
Comme un langage
la métaphore et le signifiant Hélas, l’inspiration psychanalytique n’est pas la seule. La réflexion ne se fait pas toujours sur des « pierres vives ». L’idée d’un emboîtement de la métonymie dans la métaphore est, par exemple, introduite par cette étrange « observation », dont les partisans de la rhétorique générale auraient pu faire des gorges chaudes : « Quand on lit les rhétoriciens, on s’aperçoit que jamais ils n’arrivent à une définition complètement satisfaisante de la métaphore, et de la métonymie. D’où résulte par exemple cette formule, que la métonymie est une métaphore pauvre. » L’idée est étrange. On aimerait en connaître l’auteur. Probablement s’agit-il d’une équivoque sur le terme grec metaphora : la métonymie peut en effet apparaître, comparée à la « métaphore par analogie », comme un trope du pauvre – mais ce serait alors jouer avec le mot grec, qui désignait précisément le trope en général. Et Lacan d’ajouter, ce qui achève de poser problème : « On pourrait dire que la chose est à prendre dans le sens contraire ».151 Et, de fait, ce passage possède une véritable ambiguïté, qui résume bien l’incertitude plus générale de l’auteur sur la question de la métaphore : il expose clairement le souhait de faire apparaître la métaphore comme une pauvre métonymie, probablement parce que, plus encore que celle-ci, elle substitue une chose à une autre, elle manquerait donc le réel par excellence – à cela, on reconnaît le Lacan néo-rhétoricien, structuraliste – mais, confronté à la question du symbolique, il est invité régulièrement à abandonner ce soupçon, à percevoir dans la métaphore le témoignage d’une capacité supérieure de l’être humain, certes ambivalente, mais digne d’être distinguée – et là, on reconnaît davantage le thérapeute, malgré l’ambiguïté qui se déplace, qui affecte aussi la notion de symbolique. Ce balancement, on l’observe constamment. Dans l’extrait sur le « point de capiton » cité plus haut, la métaphore est à la fois ce par quoi l’enfant « élève le signe à la fonction de signifiant, et la réalité à la sophistique de la signification ».152 S’il n’y avait là qu’un rappel sur la difficulté à atteindre le réel, sur la capacité de la métaphore à guider mais aussi à aveugler, ce ne serait pas gênant. Mais de telles phrases témoignent d’un refus fréquent, chez Lacan, de situer le langage, d’articuler de façon précise et nuancée la métaphore à l’inconscient et au « système préconscientconscient ». Aussi la métaphore, outil reconnu d’une conquête, moyen avéré d’autonomie, retombet-elle aussitôt dans la menace de l’aliénation, sans qu’apparaisse clairement le chemin d’une émancipation, celle-ci se donnant volontiers pour une illusion. Ce trait-là nous parle évidemment de Lacan, de ce « complexe » touché du doigt par Roustang dans son dernier chapitre, lorsque la psychanalyse est comparée à un « délire scientifique » et que l’analyste se reconnaît « un essai de rigueur » comparable à celui du psychotique.153 Mais il nous parle aussi d’un travers plus large, collectif, qui s’incarne avec suffisamment de netteté dans le structuralisme. Comment penser une émancipation du système quand la théorie a exclu la diachronie ou, plus exactement, quand elle s’est bâtie sur des concepts qui font système avec cette exclusion, qui n’aident pas à repérer les événements de sens, qui les écrasent sous des constantes ? C’est ainsi, par exemple, que LeviStrauss peut nommer « contradiction », dans La Pensée sauvage, ce qui apparaît comme un paradoxe : alors que, dans « le système mythique », un certain nombre d’éléments « masculins » sont valorisés, l’homme entrant en correspondance avec l’initié, le sacré, ce qui fertilise, ce qui purifie, il s’étonne de les voir en même temps « posés comme homologues à la saison des pluies qui est celle de la famine, de l’isolement, et du danger ». Autrement dit, au moment même où l’anthropologue est invité à sortir de sa « loi d’équivalence entre des contrastes significatifs », où il décèle une complexité irréductible au code, relevant d’un réseau de discours, il s’y accroche en proposant l’idée d’un double système : « le primat de l’infrastructure », ici naturelle (« la géographie, le climat »), briserait le système « idéologique », où prévaut « le rapport inverse » entre les hommes et les femmes, mais serait régulé et « masqué » par les autres dichotomies.154 Il en va de même chez Lacan, du moins dans ses grandes lignes : confronté à une « contradiction », à un paradoxe, il est tenté de l’écraser sous le système, du moins quand il cède au modèle structuraliste que nous avons vu émerger à propos de la métaphore, qui l’invite à négliger la nuance, les « exceptions » – en l’occurrence la possibilité pour le discours de s’émanciper, à des degrés divers, de la logique inconsciente. Car, évidemment, il ne s’agit pas de nier l’existence d’un système dominant dans la pensée lacanienne – même si, comme j’ai cherché à le montrer jusqu’alors, Lacan résiste à ce système, ce qui donne précisément à sa prose ce caractère particulier, qui lui a conféré une aura incroyable, une apparence de nuance, de richesse inouïe, d’intégration dialectique des contradictions. C’est à ce niveau-là que Nanine Charbonnel a raison : la ressemblance ne joue pas, en apparence, un grand rôle pour Lacan, et la substitution en joue un trop grand. Mais il faut alors aller plus loin : ce n’est pas la « contrefaçon de Ferdinand de Saussure » et la « contrebande sur la rhétorique » qui posent le plus problème chez lui. Ces contrefaçon et contrebande sont même plutôt bienvenues, et nous devons plutôt regretter qu’il ne soit pas allé plus loin dans ce sens, qu’il soit resté malgré tout si fidèle à Saussure et Jakobson. Non, ce qui est le plus déterminant, me semble-t-il, c’est la fameuse théorie de la prévalence du signifiant – qui, en radicalisant certains aspects de ses inspirateurs, en a justement accentué la mauvaise part. C’est elle qui rend compte le mieux, qui explique l’ensemble des distorsions, dans la théorie de la métaphore. Pour l’exposer, il n’est d’ailleurs pas besoin de faire intervenir tout de suite la théorie du signe, ni celle de la figure. On peut se contenter de l’exposé proposé par Jean Laplanche, dans son cours du 24 janvier 1978 : il s’appuie pour cela sur un développement de Freud, dans Projet de psychologie scientifique, consacré à l’obsession hystérique. Expliquant les pleurs de l’hystérique par la formation d’un « symbole mnésique », l’analyste viennois établit un rapprochement avec la symbolisation « normale » : dans les deux cas, un déplacement s’opère, c’est un autre objet qui se met à porter les affects liés à une circonstance, à une personne, à une patrie, etc. Comme le souligne Freud, le symbole s’est « complètement substitué à l’objet ». Voilà le cœur de la théorie de Jacques Lacan. Seulement, comme Laplanche le souligne après Freud, cette substitution n’est complète que dans les cas pathologiques, celui de l’hystérie en l’occurrence : le soldat qui « se sacrifie pour un morceau d’étoffe multicolore » et le chevalier « pour le gant de sa Dame » ont pleinement conscience de la « substitution », à tel point que j’ajouterais que cette dernière notion n’est plus nécessaire – ils font le lien entre le symbole et ce qui est symbolisé. Jean Laplanche ajoute : « le symptôme, le gant, ne fait pas écran ».155 Comme à son habitude, lorsqu’il utilise une comparaison, Freud prend donc soin de distinguer avec une égale netteté les points de convergence et de divergence : il souligne à la fois la proximité entre l’état pathologique et l’état « normal » et la différence qui subsiste entre eux. C’est ici que Lacan intervient, qu’il s’autorise quelques libertés : puisque rien n’est extérieur à la juridiction de l’inconscient, ne peut-on affirmer que le symbole, ou le « signifiant », pour parler comme lui, impose toujours sa loi à la conscience ? L’idée n’est évidemment pas illégitime : Freud a suffisamment montré qu’il n’existait pas de frontière stable entre le « normal » et le « pathologique », que nous étions constamment soumis à l’action de l’inconscient. Seulement, Lacan s’abstient de considérer à quel degré nous le sommes et c’est là, par moments, que la généralisation du propos freudien devient intenable, que l’homme n’est plus considéré comme le maître de son destin, comme pouvant le devenir du moins, que la conscience est réduite à une illusion. Pour donner une idée de la puissance de trouble d’une telle extension du « symbolique », on peut mentionner cette réflexion, dans la fameuse intervention de Laplanche et Leclaire, au colloque de Bonneval, en 1959, pourtant remarquable : « À vrai dire, la question ne nous semble pas résolue facilement de savoir s’il existe des métaphores purement conscientes ». Comment une telle question a-t-elle seulement été possible, de la part d’analystes dont l’activité consiste précisément dans l’extrême limite de leurs moyens à rendre conscient ce qui ne l’est pas ? Mieux que quiconque, ils savent que la pleine conscience de soi, de ses facultés, est un pari, un défi, une tâche infinie. Comment refuser à la métaphore ce qu’on accepte d’un patient ? N’est-ce pas que, pour eux, la métaphore est un être à part ? Là où ils ont accepté la possibilité d’une émancipation pour l’homme, là où ils sont obligés de le faire, par leur travail, ils ne reconnaissent pas la même possibilité à une figure de rhétorique, à un outil de la langue parce que, précisément, à cause de tout le corpus structuraliste, ils ont placé celle-ci trop loin dans l’inconscient. On sait en effet que, pour Lacan, depuis le discours de Rome de 1953, « l’inconscient est structuré comme un langage » et que c’est essentiellement à la métaphore et à la métonymie qu’il revient, en psychanalyse, à partir de 1956, de l’attester, en vertu d’une association entre ces figures de rhétorique et le langage qui, pourtant, va d’autant moins de soi qu’elles sont rapprochées par ailleurs de la condensation et du déplacement, à savoir des deux principaux mécanismes du « processus primaire ». C’est évidemment Jakobson qui fournit la clef, grâce à son étude des aphasies, qui semble corroborer la présence des deux tropes à un niveau inférieur à la conscience vigile. Jacques Lacan, en reprenant l’idée, en l’appuyant lui aussi sur la description des aphasies, la conforte à son tour de son autorité propre. Et il ne s’arrête pas là : il importe les notions de métaphore et de métonymie au moment même où il étudie les psychoses. Ce geste-là me paraît significatif. Il témoigne une nouvelle fois de l’ambivalence de Lacan à l’égard de la figure qui nous intéresse. Un peu comme dans « Deux aspects du langage… », où Jakobson proposait l’idéal d’un équilibre entre les deux pôles mais suggérait en même temps l’existence d’une pathologie propre à la métaphore, on ne sait au juste les rapports de la métaphore à la maladie mentale chez Lacan. Si ce dernier commence par relever, en mai 1956, l’absence de la moindre métaphore chez le président Schreber, c’est-à-dire cette incapacité du patient à mettre à distance ses représentations, la façon dont il revient à cette articulation entre la métaphore, telle qu’il l’a définie, et la psychose est confuse : il se contente de noter que « le phénomène délirant dénude […] à tous les niveaux la fonction signifiante comme telle » et il relève des « équivalences » dans le discours du malade, marquées par une certaine absurdité et une forte « assonance », une recherche « de l’ordre du signifiant, c’est-à-dire de la coordination phonématique ». Il indique d’ailleurs un 645 symbole : « les oiseaux du ciel », sans cervelle, qui correspondraient selon Freud à des jeunes filles. On le sent fortement séduit par l’idée que les états pathologiques sont marqués par l’absence de coordination et, partant, que la métaphore serait impossible pour le psychotique à cause de « cette sous-structure cachée qu’est la métonymie ». Autrement dit, l’idée apparaît, discrètement, que la métaphore pourrait être une sorte de retour – mais « cultivé », « poétique » ou autre – à la folie dont la métonymie aurait extrait le patient.156 C’est probablement ainsi que l’on pourrait expliquer l’ambivalence persistante de la métaphore chez Lacan, alors même qu’elle est censée témoigner du triomphe du symbolique. Bien sûr, nous sommes là dans le « sous-texte », dans ce qui est suggéré. La thèse explicite est plus prudente, le symbole englobe les deux figures : la psychose est un envahissement du sujet par « le signifiant », un affranchissement du « signifié », où le symbole incompris prend toute la place.