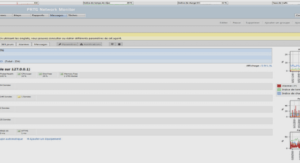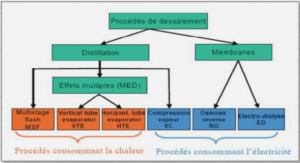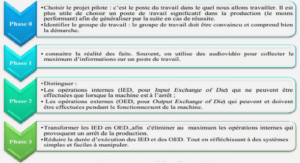LA MONARCHIE BRITANNIQUE À L’ÉPREUVE DU TEMPS
L’institution monarchique à travers les grandes révolutions anglaises du 17ème siècle
L’ère élisabéthaine fut une période pendant laquelle l’Angleterre connut un développement remarquable dans tous les domaines. Ces avancées considérables étaient surtout rendues possibles par les avantages politiques, sociaux, économiques et religieux dont jouissait l’Angleterre pendant cette période, et qui à la longue lui ont assuré une avance cruciale sur certaines puissances européennes. Le royaume avait, en effet, bénéficié d’un gouvernement central fort qui assurait la sécurité du commerce et de l’industrie, mais intervenait relativement peu dans les affaires économiques. Selon Alan Macfarlane, cela fut crucial: If we accept the view attributed to Adam Smith… that little else is required to carry a state to the highest degree of opulence from the lowest barbarism, but peace, easy taxes, and a tolerable administration of justice…then the English political system provided such a basis. It guaranteed peace through the control of feuding, taxes were light and justice was uniform and firmly administered from the thirteenth century to the eighteenth century.. 2 C’est sans nul doute ce remarquable développement perceptible dans tous les secteurs de la vie de la nation qui fait dire à G. R. Elton que : « The Age of Elizabeth is rightly regarded, not only by historians but also in the popular memory, as a time of greatness breeding greater things still than it actually witnessed ». 3 Et C. M. Cippola d’ajouter : « the English were conspicuous for some of the qualities that we nowadays associate with the Japanese ». 4 Cependant, il serait faux d’exagérer le degré d’importance et de progrès atteint par l’Angleterre élisabéthaine. Dans beaucoup de domaines – économique, industriel, démographique – l’Angleterre était encore éclipsée par certains de ses voisins du continent, et il a fallu attendre la deuxième moitié du 19ème siècle, sous le règne de Victoria, une autre reine mythique, pour voir le royaume se hisser inexorablement au sommet de l’échiquier international et devenir la première puissance du monde. Ce règne si remarquable a eu un impact désastreux sur le règne des Stuarts qui a conduit aux révolutions de 1649 et 1688. En effet, dès le début du siècle, les rapports entre le Parlement anglais et le pouvoir royal commencèrent à se détériorer. Des frottements se produisirent surtout après le refus des députés de cautionner les dépenses de guerres incessantes du roi. Le gouvernement tenta de trouver des ressources en dehors du Parlement, ce qui suscita de la part de la majorité des députés une vive opposition. En 1629, le roi Charles I dissout le Parlement qui n’est plus réuni jusqu’en 1640. Cette période fut marquée par de cruelles persécutions dirigées contre les adversaires du roi, par la répression du soulèvement irlandais et par d’autres faits analogues. En 1640, une révolte éclata en Écosse, dont la répression exigeait d’énormes ressources, ce qui obligea le roi à convoquer le Parlement. Ce parlement communément appelé le Long Parlement – adopta vis-à-vis du roi une attitude de nette opposition. En 1642, le roi tenta un coup d’État, et exigea du Parlement la livraison de cinq députés. Cette exigence provoqua des troubles à Londres, surtout dans la population commerçante, et le roi fut obligé de fuir sa capitale. Dans le conflit qui l’opposait au Parlement, le roi était soutenu par la noblesse et le haut clergé. Quant au Parlement, il était soutenu par les commerçants et industriels des villes. Le parlement, sous l’égide d’Olivier Cromwell, et appuyé par la petite bourgeoisie des villes et des campagnes, remporta la victoire et établit une république. Après la mort de Cromwell et une courte période de gouvernement de son fils Richard, le Parlement nouvellement élu décida la restauration de la monarchie (1660). Le Parlement réactionnaire continua pourtant à combattre le pouvoir absolu de la royauté. Et en 1688, les whigs prirent les armes contre le roi Jacques II qui se refugia en France sans même leur avoir résisté. Cette seconde Révolution, appelée « Glorieuse Révolution » par les 95 historiens bourgeois, à la différence de la première qu’ils qualifiaient de « grande sédition », fut primordiale dans l’évolution politique du royaume. L’esprit de la seconde révolution, pacifique et qui s’apparentait à un réformisme modéré, fut mis en pratique dans la Déclaration des droits (Bill of Rights du février 1689). Cette Déclaration fonctionnait comme un principe de limitation du pouvoir royale à l’égard des sujets. Son article 1, Debet rex esse sub lege, soumettait le roi au respect strict de la loi et visait à éviter les dérives absolutistes dont Cromwell avait donné l’exemple. Le Parlement devint le principal organe du pouvoir et les droits fondamentaux des sujets anglais étaient affirmés. L’article 10 complétait les dispositions judiciaires de l’Habeas Corpus de 1679. Lord Shaftesbury, le chef du parti Whig, parvint à faire voter cette loi le dernier jour de la session du Parlement qui fut dissout par le roi Charles II. Les Whigs, qui jouèrent un rôle important dans la révolution de 1688, s’illustrèrent par leur opposition à l’absolutisme royal et par leur tolérance envers les dissidents religieux. Après la révolution, les nouveaux monarques, Guillaume III d’Orange et Mary II, furent obligés de souscrire à la fameuse Déclaration des Droits qui établissait la validité inconditionnelle des lois promulguées par le Parlement ; le roi ne fut autorisé à entretenir d’armée qu’avec la sanction du Parlement : la liberté de parole et de pétition fut garantie. Cette Déclaration, attestant à l’époque une victoire de l’aristocratie et de la noblesse, marqua aussi la fin de l’absolutisme, et ouvrit les voies au développement ultérieur de la bourgeoisie anglaise. Si la « Glorieuse Révolution » de 1688 put établir sans effusion de sang un régime libéral, ce fut indéniablement grâce à la « grande sédition ».
La monarchie anglaise: de l’« Age d’or » à la Révolution de 1649
Élisabeth I, que l’admiration universelle a placée au-dessus de la critique, nous dirions presque de l’éloge, prenait, en 1558, les rênes d’un empire agité, dont plusieurs ennemis, tous redoutables et tous dangereux, avaient médité la ruine : un Philippe II, dont la politique perfide et intelligente savait faire des traîtres dans tous les conseils des princes, et susciter des partis dans tous les États ; un duc d’Albe, l’appui de son maître par ses victoires, le destructeur de la société par ses barbaries ; un duc de Parme, qui joignit aux ruses italiennes l’avantage du flegme espagnol ; une Catherine de Médicis5, qui préférait d’achever par un crime ce qu’elle aurait pu emporter facilement par une vertu ; un duc de Guise, que le bonheur de réussir à tout, rendait hardi à tout entreprendre ; un Sixte-Quint, qui comptait pour rien de dominer, s’il ne foulait à ses pieds des couronnes ; une Marie Stuart, dont les malheurs ont été si grands, qu’ils ont plutôt obscurci que relevé ses belles qualités. Après tout, Élisabeth voyait autour de son trône des écueils plus dangereux encore que les orages qui la menaçaient au loin. Les catholiques, qui soupçonnaient sa croyance, quoiqu’elle fit encore profession de leur religion, paraissaient disposés à lui contester une couronne, qui, dans leurs principes, ne lui appartenait pas, puisque l’union d’Henri avec Anne Boleyn, n’était qu’un concubinage. Les novateurs, que la persécution avait unis trop étroitement, étaient résolus à dominer, ou à s’ensevelir sous les ruines du trône. Les Irlandais, esclaves de la cour de Rome, et pensionnaires de celle de Madrid, épousaient aveuglément les fureurs de ces deux couronnes. Les grands formaient tous des prétentions, ou pour gouverner la reine, ou pour l’épouser, ou pour la détruire. Le parlement était d’autant plus avide d’autorité, qu’il en était privé depuis longtemps. La reine vit tous ces écueils, et les évita par ses grands coups de politique, qui font un spectacle rare sur la scène du monde, parce qu’il n’est pas commun d’y voir des acteurs du caractère d’Élisabeth. On est étonné encore aujourd’hui comment une jeune princesse, sans expérience, sans amis, sans conseil, sans un droit trop décidé au trône, a pu régner avec plus de dignité, d’autorité, de tranquillité, qu’aucun monarque qui avait porté alors la couronne. Tandis que l’Europe entière était en proie aux divisions domestiques, aux guerres étrangères, aux factions, à la misère, aux empoisonnements, aux assassinats, à toutes les horreurs qui ont rendu le seizième siècle odieux et célèbre, l’Angleterre voyait son commerce s’étendre, ses lois s’affermir, sa police se perfectionner. L’histoire doit recueillir avec soin les principes sublimes d’une administration si parfaite. Élisabeth – sans que le parlement y ait eu d’autre rôle que de faire exécuter ses ordres – réussit cette prouesse grâce à une modération circonspecte, qui lui fit mépriser sagement la brillante folie des conquêtes ; à une noble jalousie de la puissance suprême qu’elle sut également soutenir par l’insinuation et par la force ; à des principes fixes et invariables de gouvernement, dont rien ne put jamais l’en écarter ; à une attention scrupuleuse à réprimer les abus naissants, ou à les contenir 99 dans les limites précises qu’exigeait la politique ; à une dextérité singulière à saisir les opportunités, qu’elle ne perdit jamais par faute de diligence, ou par trop de précipitation ; au talent énigmatique, et qu’on peut louer et blâmer, de faire naître des haines et d’éterniser des discordes parmi ses ennemis ; au choix toujours judicieux, toujours éclairé, toujours utile de ses ministres, de ses généraux, de ses favoris même. A ces grands talents, Élisabeth ajouta l’apparence de vertus éclatantes et solides, qui sont l’ornement et l’appui du trône. Quoique souverainement ambitieuse, et éprise de son pouvoir, qu’elle sut maintenir, elle parut toujours désintéressée, dévouée à la religion anglicane, quoique indifférente pour tous les cultes, passionnée pour le bonheur de ses sujets, quoique ardente seulement pour sa propre gloire, pleine de franchise et de probité, quoique peu scrupuleuse dans les affaires. Élisabeth a su parfaitement unir les petites vanités de femme avec les sentiments des grands hommes, les ridicules d’un sexe avec les qualités de l’autre, beaucoup de défauts d’un particulier avec tout ce qui fait un souverain parfait. Sous Élisabeth I, le petit royaume d’Angleterre, cerné au nord par une Écosse indépendante et hostile, à l’ouest par une Irlande incontrôlée, sur le continent par l’essor des grandes monarchies absolutistes d’Espagne et de France, se révéla, au cours de péripéties dramatiques, un partenaire majeur de l’aventure européenne et mondiale. L’Angleterre affirma alors une personnalité mûrie au cours de la guerre de Cent Ans, puis forgée de main de maître par les premiers rois Tudors. Modelée tour à tour par la ténacité rusée d’Henri VII, puis par les emportements calculés d’Henri VIII, elle développa les bases sociales et économiques de sa jeune puissance. Le déclin de la féodalité, accéléré par l’action gouvernementale, fit apparaître sur la scène nationale des acteurs nouveaux : les industriels, les commerçants et les aventuriers qui se renforçaient aux dépens des anciens meneurs 100 du jeu politique et économique, la noblesse et l’Église. Encouragées par la « réforme henricienne », les tendances protestantes, luthériennes, puis bientôt calvinistes supplantent, dans les milieux gouvernementaux, les villes d’université ou de négoce, et surtout Londres, le vieux catholicisme resté ailleurs vivace. Sous le règne du successeur d’Henri, Édouard VI, l’Angleterre s’orienta résolument vers la Réforme, non sans parfois de vives résistances. Ainsi se cherchaient les formules originales qui devaient fournir à l’Angleterre une religion adaptée aux nécessités de son évolution. La Couronne entendait se libérer des ingérences romaines ; mais, malgré leur autoritarisme absolutiste, les gouvernants étaient attentifs aux tendances socio-économiques et à leurs corollaires spirituels. Le Parlement conquit une influence inégalée en assumant la responsabilité suprême des initiatives religieuses d’Henri VIII et d’Édouard VI. Une politique extérieure, nouvelle elle aussi, reconnaît dans l’équilibre des forces en Europe le meilleur moyen pour l’Angleterre de participer en arbitre aux affaires du continent, et surtout à l’exploitation accrue des grands secteurs du commerce européen. La société, en profonde mutation, où les valeurs du système manorial étaient déjà concurrencées par celles du capitalisme urbain, industriel et commercial, allia à la quête frénétique de l’argent le goût de l’aventure spirituelle manifesté depuis longtemps par tant d’esprits savants et hardis. C’est dans ce climat de changements, de véhémence, d’équivoques politiques et religieuses, mais aussi d’énergies déchaînées, de culture à la fois brutale et raffinée, que grandit la personnalité énigmatique d’Élisabeth. Incertaine de la légitimité de sa naissance, tour à tour confinée, menacée, puis rendue aux honneurs, elle a souffert de l’ambiguïté de sa situation, de la méfiance de son aînée Marie Tudor (issue d’un légitime mariage), des ambitions qui, tôt, ont essayé de l’utiliser. Nul doute que son apprentissage de la vie ne l’ait marquée profondément, ne l’ait contrainte à ne se fier qu’à son instinct politique, utilisant pour survivre – mais 101 aussi pour dominer – tous les prestiges d’une instruction brillante, d’un esprit subtil et impérieux, d’une féminité dont elle use avec un brio déconcertant. Ce qui fit la grandeur et le caractère du règne d’Élisabeth (à une époque où s’est amorcé sans se résoudre le débat sur la supériorité de la Couronne ou du Parlement), c’est, dans le pragmatisme de l’exercice du pouvoir, la connivence presque constante que la souveraine sut établir entre ses propres aspirations et celles de la majorité de ses sujets.
Les mutations de la monarchie sous Élisabeth
Le règne de la reine Élisabeth I fut à plusieurs égards l’une des périodes les plus remarquables et les plus marquantes dans la longue marche de la monarchie anglaise. Il fut, en effet, un tournant important dans l’histoire de l’Angleterre car il marque l’ascension fulgurante du royaume de sa position de petit pays féodal à une position de grande puissance européenne, et ce seulement en l’espace de moins de quarante-cinq ans. Et aucune sphère du tissu social ne fut épargnée par ce développement remarquable et cette vivacité soudaine. Cette extraordinaire évolution de l’Angleterre élisabéthaine valut à la reine non seulement une reconnaissance universelle, mais aussi et surtout la mythification de sa personne. C’est que la reine elle-même était une figure extraordinaire, pétrie de qualités royales et nobiliaires mythiques dont nous avons fait mention dans la première partie de notre travail. Dans ce sous-chapitre nous nous proposons d’examiner la façon dont ces vertus mythiques déjà présentées de façon générale dans le dernier sous- chapitre de la première partie – à savoir la perfection physique et intellectuelle, la magnificence, le pouvoir de dissimulation, le devoir de prudence, la justice et la libéralité – ont été effectivement incarnées par la reine Élisabeth dans 102 sa vie de tous les jours, dans l’exercice de ses fonctions régaliennes et dans ses rapports avec ses sujets. La reine Élisabeth I est trop souvent présentée comme une femme imposante, sereine et majestueuse ; comme quelqu’une qui est restée physiquement indemne malgré le passage du temps. Déjà, en pleine fleur de l’âge, beaucoup la trouvaient fort jolie. Elle était de taille moyenne et avait une magnifique allure. Ses cheveux étaient dorés mais plus roux que jaunes et sa peau, bien que de couleur un peu sombre, était lisse. Elle avait des yeux d’une beauté frappante et surtout de magnifiques mains qu’elle savait si bien exposer. Et même si certains pensent que ses portraits sont souvent exagérés, il demeure évident qu’elle était une charmante femme de la Renaissance, toujours splendide dans son habillement. Elle est dépeinte dans l’Encyclopaedia Britanica comme une femme qui possédait « the red haired stock of the Tudors and like a Welsh woman with a sharp oval face high cheekbones, narrow forehead, hooked nose » 6 . Dans sa célèbre œuvre The Faerie Queene (1590-1596), Edmund Spenser la présente comme « Gloriana » et lui dédie le livre en ces termes: « to the most high, mightie and the most magnificent Empress renowned for pitie, vertue and all gratious government, Elizabeth by the grace of God Queen of England, France and Ireland and of Virginia, defender of Faith…» 7 . Dans Kenilworth (1821) Walter Scott la voit comme « an accomplished and handsome woman, the pride of England, the hope of France and Holland, the dream of Spain » 8 ; et il la présente en ces termes: {…} Amid a court of lords and ladies, yet so disposed around her that she could see and be seen on all sides, came Elizabeth herself, then in pride womanhood, in the full glow of 6 Encyclopaedia Britanica, « Elisabeth I », p. 343. 7 Cité par Sir Waller Scott, Kenilworth, London: J. M. Dent & sons Ltd, 1958, P.378. 8 Sir Walter Scott, op. cit., P. 378. 103 what in a sovereign was called beauty and in the lowest rank of life have been truly judged a noble figure, joined to a striking and commanding physiognomy.9 A cette perfection physique mythique du monarque, la reine Élisabeth y associait une autre, celle-là intellectuelle. En effet, très jeune cette perfection mentale commençait à se révéler au grand jour. Déjà au berceau Élisabeth était une enfant prometteuse qui possédait l’art d’attirer le regard des autres. Wristhesly, secrétaire de Henri VIII, qui lui avait rendu visite le 17 novembre 1536 au palais d’Hunsdon – où elle était confinée après l’exécution de sa mère – fut frappé par sa précoce faculté de compréhension, et le rapport qu’il fit d’elle était frappant : I went to my lady Elisabeth’s grace, and to the same made his majesty’s most hearty commendations, declaring that his highness desired to hear of her health, and sent his blessing; she gave humble thanks, inquiring after his majesty’s welfare, and that with as great a gravity as she had been forty years old. If she be no worse educated than she now appeareth to me, she will prove of no less honour than beseemeth her father’s daughter, whom the Lord long preserve140 . À cinq ans, princesse Élisabeth était une fillette pleine d’entrain, un moulin à paroles. Et déjà à cet âge, était perceptible en elle l’éveil de ce désir de plaire qui caractérisait tant sa mère Anne Boleyn. Son père Henri VIII était même étonné et très attiré par ses bavardages et ses manières trop confiantes. Il est remarquable que même à ce tendre âge, personne ne pouvait la rencontrer sans être frappé par ses plaisants dons naturels141 . Adolescente, Élisabeth était une fille saine, dotée d’un esprit vif et d’une vivacité naturelle mêlée d’une circonspection acquise. Fille très intelligente, studieuse et dotée d’une mémoire remarquable, elle avait profité des leçons que lui donnaient ses professeurs de choix comme John Cheke, Richard Coxe, Jean Balmain, Battista Castiglione, William Grindall et Roger Ascham, professeurs que seule la 9 9 Sir Walter Scott, op. cit., p. 167. 140 Agnes Strckland, op. cit., P. 7. 141 Louis Wiesener, La Jeunesse d’Élisabeth d’Angleterre (1533-1558), Paris : Hachette, 1878, pp. 20-38 104 Renaissance pouvait produire. Princesse Élisabeth parlait et écrivait le Français, le Latin et l’Italien couramment ; elle était capable de lire l’ancien testament en Grec, et pouvait soutenir une conversation en Espagnol142. Elle possédait certaines connaissances en astronomie et en mathématiques. Et tout cela n’allait pas sans un soupçon de pédanterie. Une lettre datée du 4 avril 1550 et écrite par Ascham à son ami John Sturm, le célèbre érudit strasbourgeois, présentait le tableau des études et mérites d’Elisabeth en ces termes : It is difficult to say, whether the gifts of nature or of fortune are most to be admired in my distinguished mistress. The praise which Aristotle gives, wholly centres in her: beauty, stature, prudence and industry. She has just passed her sixteenth birthday and shows such dignity and gentleness as are wonderful at her age and in her rank. Her study of true religion and learning is most eager. Her mind has no womanly weakness, her perseverance is equal to that of a man, and her memory long keeps what it quickly picks up. She talks French and Italian as well as she does English, and has often talked to me readily and well in Latin, moderately in Greek. When she writes Greek and Latin, nothing is more beautiful than her handwriting. She delights as much in music as she is skilful in it. In adornment she is elegant rather than showy…I am inventing nothing my dear Sturm ; there is no need.143 Si Élisabeth était tant dévouée à ses études ce n’était pas parce qu’elles représentaient à ses yeux un simple passe temps ; tout au contraire, elles lui servaient de support et de remontant pendant les moments les plus durs de sa vie, surtout après le complot de Wyatt. A ces moments difficiles, elle faisait appeler Ascham et ils lisaient ensemble les discours d’Aeschines et Demosthenes. Et cela fut, sans nul doute, un pas important dans la formation de son esprit, car ces études des œuvres classiques lui donnaient la possibilité de se former dans la gestion des affaires politiques. Ces classiques lui fournissaient, en effet, les assises politiques indispensables à l’édification de sa propre politique. Avec Ascham, elle avait presque lu toute l’œuvre de Cicero et de Livy, les oraisons d’Isocrate, les tragédies de Sophocle et le Nouveau Testament en Grec. Cet amour qu’Élisabeth avait pour 142 142 Louis Wiesener, op. cit., pp. 20-38 143 J. E. Neale, op. cit., p. 26. 105 les études ne s’est pas amoindri avec son accession au pouvoir, il est demeuré vivace en dépit de ses multiples tâches de reine144 . En définitive, la sévère éducation qu’Élisabeth a reçue pendant sa jeunesse lui a procuré une formation judicieuse et une base solide pour sa politique, et ses études ont non seulement fait d’elle une érudite mais elles ont aussi rehaussé son prestige et ont grandement contribué à sa mythification. En effet, une fois sur le trône Élisabeth a fait montre d’une intelligence remarquable comme l’atteste, du reste, l’en-tête de la première proclamation signée de sa main après son accession : Elisabeth, by the grace of God, Queen of England, France and Ireland, and Defender of the Faith, & 145 . Ce modeste mais rusé « et cetera » c’est tout Élisabeth. C’était indéniablement un pas audacieux mais très prudent : audacieux parce qu’il maintenait de façon implicite la théorie de la Réforme anglaise selon laquelle la papauté n’est qu’une usurpation de l’ancienne autorité de la couronne et qu’il n’était nul besoin d’aller au parlement pour conférer la direction de l’église au monarque ; prudent parce que, après tout, rien n’apparaissait derrière l’expression « et cetera », ce qui laissait le monde catholique deviner et espérer pour l’avenir. Ainsi, il apparaît évident que c’est à de telles manœuvres intelligentes et prudentes qu’elle devait une grande partie de sa réussite politique. D’ailleurs, dans ses années d’apprentissage de la vie sous Édouard VI et Marie, c’est à sa prudence et surtout à son intelligence qu’elle devait son salut ; intelligence qui lui avait permis de profiter pleinement des difficiles leçons de politique qu’elle prenait et dont l’assimilation constituait les bases de son admirable génie politique.
Introduction |