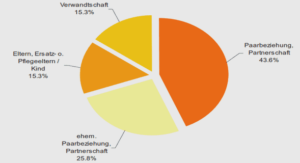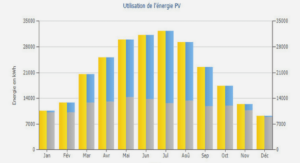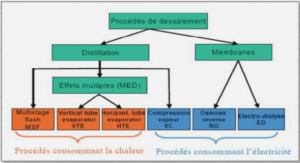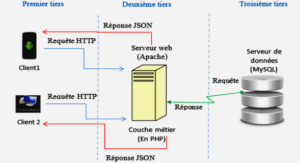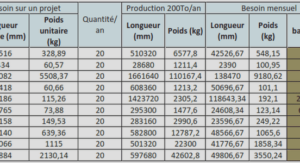La rhétorique et les paradoxes.
À cette étape de mon enquête, et conformément aux acquis des précédents chapitres, je me propose de réfléchir à l’état des représentations de la rhétorique et plus largement du discours dans nos démocraties européennes. Après avoir levé certaines ambiguïtés, je m’attacherai d’une part à mettre en lumière les lieux, au sens de topoï, sur lesquels se fondent notre relation au discours, et qui déterminent les fonctions qu’on lui donne dans l’espace social autant que les limites, voire les interdits qui lui sont imposées. D’autre part, je formulerai un certain nombre d’hypothèses quant à l’influence de ces lieux sur nos pratiques langagières et finalement sur notre expérience de la démocratie. À cet égard, je pose l’existence d’un lien étroit entre les représentations du discours (ce qu’il est, ce à quoi il sert, ses bons et ses mauvais usages), la valeur sociale qu’on lui donne, c’est-à-dire en fait la méfiance qu’il continue d’inspirer, laquelle justifie le continuel travail de domestication qu’il subit, et l’exercice aussi bien individuel que collectif de la liberté. L’idée est donc de montrer que l’évolution des qualifications propres à l’activité du discours, persuasif notamment, a affecté en profondeur nos façons de penser le monde (et non pas seulement de le dire), en ruinant les bases pratiques de ce qu’on peut appeler le « paradigme rhétorique » présenté plus haut. Non qu’il s’agisse là d’un événement décidé ou concerté, le problème est selon moi plus sérieux, car il touche nos possibilités mêmes de faire usage de ce paradigme, et constitue une conséquence de l’évolution de nos capacités proprement cognitives. Cela veut dire, que la faculté de penser le monde et d’interagir avec lui sur un mode rhétorique nous est devenue inaccessible, non pas seulement parce que la matière rhétorique ne s’enseigne plus, c’est un fait, nous avons eu tout loisir d’exposer la dynamique de son évincement dans le second chapitre, mais d’abord parce que cette faculté n’a tout simplement plus sa place dans notre esprit, en ce qu’elle a perdu sa valeur pratique. La rhétorique ne fait plus sens social dans la mesure où ce sur quoi elle repose (les lieux, les émotions collectives, la relation entre instruire et plaire, la prudence, etc.), et ce à quoi elle conduit au moins potentiellement (la persuasion et la levée du doute de façon temporaire mais non absolue), ont fait l’objet d’un radical travail de sape qui a fini par la rendre à la fois inacceptable politiquement et impensable d’un point de vue cognitif. De façon un peu polémique, je dirais même que la rhétorique, non comme fait, mais comme fonction du langage, comme mise en rapport du langage et de la liberté, est indubitablement sortie de nos existences. Le terme est encore employé (quoique souvent dans un but de péjoration, du moins dans le langage courant, nous avons d’ailleurs tous en tête le fameux : « ça n’est que de la rhétorique ! »), et même largement discuté, convoqué dans des productions savantes, mais il ne signifie plus rien, c’est-à-dire plus rien de concret. Alors, certes on pourrait objecter que l’on continue toujours de parler, et même, argument de choix, que l’entrée dans la démocratie a « libéré » les possibilités de prendre la parole, laquelle s’exprime aujourd’hui avec une frénésie certaine. Je ne peux bien sûr pas nier l’évidence, les faits sont là, nous n’avons pas été réduits au silence du fait de la disparition tangible de la rhétorique, bien au contraire. La situation que nous vivons se manifeste donc sous un jour apparemment paradoxal : en pénétrant dans l’ère de la parole, nous sommes (ou serions) sortis de celle de la rhétorique. Ce premier paradoxe, qui ne témoigne d’aucune relation nécessaire de cause à conséquence, révèle en réalité, selon moi, une disjonction de fond entre le fait de produire des discours (c’est-à-dire de prendre la parole), et celui de les faire en fonction du paradigme rhétorique. Disjonction qui, malgré les apparences, ne témoigne pas d’une différence de degré, selon laquelle le discours rhétorique serait un discours avec quelque chose en plus, mais d’une différence de nature car l’un et l’autre n’ont pas le même objet, ni surtout la même fonction. Cependant, une telle différence de nature n’est pensable qu’à partir du moment où la rhétorique ne se voit pas réduite à un ensemble de « recettes », réduite à sa seule dimension technique (une façon de dire et de présenter ses arguments), contre laquelle, déjà, Aristote s’inscrivait en faux : la rhétorique n’est pas un pur catalogue de procédés, car si elle confère bien une « méthode », elle fonde celle-ci sur des ressources techniques à la fois transmissibles (Rhétorique, 1354a 6-14) et en même temps à inventer.
Technique et invention.
Les faiseurs ou compilateurs de techniques, les « technologues », auxquels s’oppose le projet aristotélicien, n’ont donc jamais produit ce qu’on appelle une rhétorique, parce qu’ils avaient d’elle une vision réductrice, vision qui soumettait la pratique de l’« art » oratoire à l’application de moyens certes éprouvés (Aristote lui-même n’en doute pas), mais en quelque sorte impersonnels et désincarnés pour émouvoir et rallier le public à sa cause. En d’autres termes, la nature spécifique de la parole rhétorique ne lui vient pas uniquement de ce qu’elle fait (même si elle fait bien quelque chose suivant un certain ordre et qu’elle s’appuie sur une technique), mais d’abord de ce qu’elle recherche, ou plus exactement de la finalité particulière qu’elle se donne et des principes qu’elle mobilise pour y parvenir. Aristote constate que pour « la plupart des hommes » qui « se mêlent jusqu’à un certain point de questionner sur une thèse et de la soutenir, de se défendre et d’accuser », les succès ne sont souvent que le fruit du hasard ou d’une « accoutumance » qui dispose les orateurs à viser juste sans qu’ils puissent pourtant justifier ce qu’ils suivent au niveau principiel (1354a 3-6). Or, il demeure dans la « victoire » sans méthode quelque chose de magique, un je-ne-sais-quoi qui ne lui enlève rien (car elle demeure toujours une victoire par les mots), mais qui la confine dans l’irrationnel. Les choses se passent, les discours s’énoncent, les bataillent se gagnent (ou se perdent), mais rien de cela n’est intelligible : le résultat est là, certes, mais il reste isolé de ses causes, comme si lui seul avait du sens ou de la valeur. Partant de ce constat, Aristote fait l’hypothèse qu’il doit bien exister quelques « raisons » capables d’expliquer pourquoi « ça » marche, pourquoi certains parviennent malgré tout, malgré l’absence de méthode, à atteindre leur but, c’est-à-dire à gagner l’auditoire. L’entreprise d’un traité comme la Rhétorique, concerne donc la recherche spéculative (1354a 9-10) des raisons et donc des processus qui donnent possiblement l’accès à cette victoire que certains, justement, atteignent sans méthode, ou, plus exactement, sans avoir la conscience d’en suivre une. Assurément, l’investigation spéculative qu’inaugure Aristote ne se réduit pas à une pure réflexion sur les moyens ; elle ne s’intéresse pas au seul « comment », mais relève aussi d’un questionnement sur le « pourquoi » de la victoire, et donc sur la possibilité qui est donnée par la rhétorique de parvenir à une victoire digne de ce nom. Qu’est-ce à dire ? Qu’il s’agit à la fois de penser les fins et les moyens, et non pas seulement de faire coïncider les uns avec les autres, comme si le but lui-même ne pouvait être pensé indépendamment des ressources convoquées pour l’atteindre. En d’autres termes, la fin ne s’épuise pas dans sa pure et simple réalisation, laquelle justifierait alors la convocation de tous les moyens possibles sans avoir à les réfléchir et sans qu’il soit besoin de leur donner du sens. Mais le projet aristotélicien vise pourtant à rendre accessible à tout un chacun la technique du discours que l’on dit persuasif, c’est-à-dire à détailler ce à la faveur de quoi la persuasion s’opère. Il y aurait donc là un second paradoxe : la rhétorique remplirait la « fonction d’une Technique » (1354a 10), dans la mesure où elle vise (c’est un objectif, non un gage de succès) la découverte de ce qui conduit à la victoire par les mots, mais se refuserait, en même temps, à être une compilation de « techniques », et donc à donner des recettes. De nouveau, le paradoxe n’est qu’apparent, mais, comme je le soulignerai par la suite, notre compréhension de ce qu’est la rhétorique (comme objet de réflexions savantes ou théoriques) continue à souffrir de cette confusion dans les termes. La distinction qu’introduit Aristote à ce propos marque pourtant l’exceptionnelle nouveauté de son entreprise et porte sur trois points principaux. D’une part, la spécification technique de la rhétorique permet de séparer ce qui relève des « moyens personnels » de l’orateur, de ce qui n’en relève pas, et qui se trouve alors rejeté dans le champ de l’« extra-technique » (1355b 35). Si les premiers « moyens » sont dits personnels, cela veut dire que les seconds demeurent (1) impersonnels, extérieurs à l’art, mais surtout (2) extérieurs à la recherche propre de celui qui parle ; ils n’ont pas à être découverts. Ce sont les témoignages, aveux, écrits (1355b 35), mais aussi tout ce qu’on appellerait aujourd’hui les pièces à conviction, pour se limiter à la sphère judiciaire. En conséquence, si la rhétorique est une technique, c’est parce qu’elle ne porte pas (cela revient donc à la définir négativement) sur ce qui est déjà donné et qui se passe, dans son énoncé même ou sa présentation , d’une mise en discours venant de l’extérieur . D’autre part, et il s’agit là d’une conséquence directe de ce qui précède, nous aurons l’occasion d’y revenir, si la fonction technique de la rhétorique réside bien dans la personne de l’orateur (et non pas dans la rhétorique elle-même), c’est parce que les ressources personnelles que celui-ci convoque restent toujours à « inventer », et ne se limitent pas à être « utilisées » (1355b 35), comme le sont les preuves dites « extra-techniques ». Par suite, si la rhétorique se fait technique, c’est parce qu’elle constitue d’abord un parcours, lequel, tout en suivant un ordre, une méthode (un art au vieux sens du terme), reste chaque fois à découvrir et donc à composer. C’est pourquoi, il ne s’agit pas d’appliquer des règles abstraites et désincarnées, mais de trouver (re-trouver) ces règles, ces moyens, de les mettre à jour lorsque l’occasion s’en présente. Partant, et c’est le troisième point, la technique rhétorique ne se réinvente pas entièrement à chaque nouvelle prise de parole, loin s’en faut, le cheminement à suivre est en quelque sorte balisé et l’orateur guidé dans sa démarche, c’est-à-dire dans l’invention qu’il mène au sujet des « preuves » capables de valider ses dires.
En fin de compte, le mouvement de la technique rhétorique est triple : (1) en tant que processus dynamique, elle offre un support à sa propre actualisation par l’orateur ; (2) elle rend ce dernier apte à découvrir ce qui est potentiellement propre à persuader l’auditoire (1355b 25), à savoir les « preuves », (3) elle lui permet de les « administrer » (1356a 1), en d’autres termes de les utiliser avec méthode. De façon assez synthétique, je me suis efforcé d’éclairer ce qui permettait de qualifier la rhétorique de technique, sans que cela conduise pour autant à l’identifier naïvement à un ensemble de procédés figés et indéfiniment exportables dans tous les contextes. Par analogie, on pourrait comparer l’activité rhétorique à l’exécution d’une peinture avec « art » (je passe volontairement sur l’épineuse question du génie artistique qui n’est pas mon propos) : il ne suffit pas de maîtriser l’usage des couleurs ou celui du pinceau pour peindre « artistiquement », encore faut-il, en chaque cas, pour chaque nouvelle œuvre, savoir inventer les moyens, forcément singuliers, uniques, de sa création. À ce titre, une remarque d’Eugene Garver me paraît tout à fait pertinente en ce qu’elle met l’accent sur le type de rationalité propre à l’activité de créer : « l’art de la rhétorique [ne s’occupe pas] seulement de production mais aussi de praxis ; non seulement de fabriquer, mais de faire . » La distinction qu’il pose est cruciale, car elle révèle ce que le catalogue de techniques est incapable d’offrir, c’est-à-dire un rapport véritablement pratique au monde et à l’auditoire. La rationalité pratique que donne la rhétorique ne saurait être (entièrement) gouvernée par des règles externes, lesquelles règles ne confèrent jamais que des compétences « productives », et donc impersonnelles. Or, nous l’avons vu plus haut, la rhétorique n’est technique que dans la mesure où la « recherche » qu’elle initie se rapporte à la personne même de l’orateur. Il n’est donc pas étonnant qu’Eugene Garver rattache le « faire » rhétorique, son orientation « pratique », à l’èthos, preuve qui, seule, est capable de rendre l’orateur raisonnable et non pas seulement rationnel . La preuve éthique est en quelque sorte l’intelligence de la raison (du logos), qui sans elle ne saurait que « produire », ou plutôt « reproduire », mais pas inventer. Sans èthos, qui oriente et nourrit l’identification puis la sélection des « moyens » rhétoriques en fonction d’un kairos accidentel, l’accès à la praxis, la sphère de l’action et du choix, demeurerait impossible. C’est aussi ce que souligne très justement François Ost lorsqu’il précise que « le rythme […] qui convient à la fabrication des choses (poiesis) » n’est pas celui de la « vie sociale » sur laquelle porte l’activité rhétorique : tandis que le premier procède d’un « temps homogène et continu », le second suit une « temporalité ouverte » dans laquelle la « raison technicienne » ne saurait se couler . Ce détour par Aristote nous a permis de surmonter, je l’espère, la situation apparemment paradoxale d’une rhétorique pensée comme technique, mais non comme technicienne, et de mettre en lumière la fonction originale de cette technique dans le processus d’invention. Nous repartirons de ces premières considérations lorsqu’il s’agira plus loin d’une part de réfléchir aux problèmes posés par la réduction « techniciste » opérée par certaines théories contemporaines du discours (rhétorique ou argumentatif), d’autre part d’analyser la notion de prudence (la phronèsis) d’avec laquelle notre modernité s’est radicalement coupée. Si nous reprenons le fil de notre réflexion concernant ce que j’ai appelé la sortie du paradigme rhétorique, une nouvelle objection pourrait toutefois être adressée, objection qui ouvre alors sur un troisième paradoxe. 1.2. L’ordre du discours et l’anthropologie Les faits, semble-t-il, parlent d’eux-mêmes et renvoient à une évidence difficilement contestable selon laquelle les locuteurs d’aujourd’hui n’ont de cesse de s’exprimer en termes rhétoriques, ou analysables comme tels. Ils font de la rhétorique comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, c’est-à-dire sans le savoir, s’efforçant de rechercher et d’agencer des preuves dites rhétoriques, susceptibles de rallier à leur cause ceux à qui ils s’adressent. Ils en appellent aux passions (la pitié, le sens du devoir, l’estime de soi, etc.), cherchent à se faire valoir en parlant (témoignant de leur autorité, grandeur, respectabilité, etc.) et s’attachent à valider leurs dires en suivant des types de raisonnements réputés acceptables (notamment l’enthymème). En tout état de cause, les locuteurs d’aujourd’hui ne parlent pas sans ordre, pis, l’absence ou le refus manifeste de se conformer à un certain ordre (attendu et supposé partagé) peut faire l’objet de sanctions immédiates dans la vie courante et tout particulièrement sur les forums et sites internet : exclusion temporaire ou définitive, suppression du message envoyé, etc. Cela plaiderait donc contre mon hypothèse initiale. La rhétorique est là, elle n’a pas disparu, elle est même plus forte que jamais. L’hypothèse d’une sortie du paradigme serait invalidée, sauf à envisager la situation présente comme paradoxale (au moins à première vue) : il peut y avoir du rhétorique dans les discours, sans que le paradigme, ou disons-le autrement, la topique dans laquelle ces discours sont produits n’ait plus rien de rhétorique, et même refuse catégoriquement les principes sur lesquels la rhétorique repose. Ma position est peut-être un peu extrême et radicale, il faudrait sans doute la nuancer (ce que je ferai par la suite). Pour autant, elle met l’accent sur la différence entre ce qui relève de facultés « rhétoriques » ordinaires sinon résiduelles, lesquelles marquent nos comportements langagiers et plus largement sociaux (façons d’être, de se présenter, de sélectionner des données pertinentes, d’interagir stratégiquement avec les autres, etc.), et ce qui relève de la conscience de ces facultés, c’est-à-dire de l’inscription de leur usage et de leur pratique au sein d’un certain type de rationalité. Ceci recouvre.