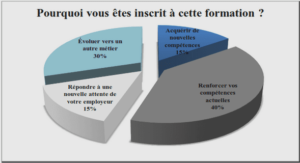Télécharger le fichier original (Mémoire de fin d’études)
Une hétérodoxie épistémologique
Le but de toute introduction est celui d’exposer les propos qui animent la recherche. Il s’agit tant de poser les questions cruciales qui sont à la base d’un travail à vocation scientifique, que d’inviter le lecteur à partager les doutes, et par conséquent, l’envie d’y trouver une réponse. Si la thèse est un combat au nom d’une idée, d’une hypothèse à vérifier, l’introduction serait alors la description du champ de bataille. Mais comme tout travail scientifique, il est nécessaire, voir indispensable, de délimiter le champ dans lequel on souhaite faire germer la pensée. Si on a essayé de décrire les objets de cette recherche, si on a formulé des hypothèses à propos de la contribution que l’on souhaite offrir à l’intelligence collective, il est temps maintenant de réfléchir sur le cadre épistémologique dans lequel insérer cette démarche.
La première évidence concerne la vocation profondément multidisciplinaire de ce travail. La ville, comme espace physique mais aussi comme symbole d’une civilisation, le cinéma, la science-fiction, la catastrophe et la modernité, sont tous des éléments récurrents. Cette hétérogénéité se traduit par le recours à disciplines différentes. La géographie (urbaine et culturelle notamment), les études sur le cinéma, la critique littéraire, la philosophie et l’histoire. Or, bien que cette variété soit considérée comme une ressource, un point fort, il est indispensable néanmoins d’établir une certaine hiérarchie et de distinguer des disciplines qui s’offrent en tant que contribution, en tant qu’enrichissement, de celle qui constituera le cadre épistémologique de base. Puisque le véritable but de cette recherche est d’interroger les espaces urbains, ce travail s’insère dans la géographie. L’enjeu n’est pas simple, car, avant de pouvoir aborder le sujet, il faut réfléchir sur le rôle que le cinéma joue au sein de cette discipline. Bien que, depuis quelques décennies, le cinéma ait commencé à trouver une place dans les réflexions des géographes, son rôle n’est pas du tout acquis. À propos des rapports entre ville et cinéma, Jean-Pierre Garnier et Odile Saint-Raymond (1996) parlaient d’un rendez-vous manqué. Aujourd’hui, presque vingt ans après, on peut parler d’un effort pour rattraper ce temps perdu. En effet les travaux sur ce sujet se multiplient. Des premiers essais de Michel Foucher et Yves Lacoste à la fin des années 1970, en passant par les anglo-saxons (Aitken et Zonn en 1994, Cresswell et Dixon en 2002 ou encore Lukinbeal et Zimmermann en 2008, juste pour faire quelques exemples), on arrive en 2014 à la publication d’un numéro des Annales de Géographie consacré entièrement au rapport entre cinéma et géographie. Au milieu, un effort considérable peut être représenté par l’encyclopédie La ville au cinéma, dirigée par Thierry Jousse et Thierry Paquot (2005), qui, malgré une approche visiblement multidisciplinaire, peut se considérer comme un travail concernant la géographie. Plus récemment, le géographe Michel Lussault fait plusieurs fois référence au cinéma dans ses travaux les plus récents (2007 et 2013), et Jacques Levy consacre en 2013 un article entier à ce sujet. On peut citer aussi la mise au point effectuée par Jean-François Staszak, qui ouvrait le fameux numéro des Annales. Mais au-delà des grands noms de la géographie francophone, on assiste à l’émergence d’une nouvelle génération de jeunes géographes, comme par exemple Bertrand Pléven et Manouk Borzakian, qui ont fait du rapport entre cinéma et géographie l’objet principal des leurs recherches. C’est au sein de cette nouvelle génération que l’on souhaiterait insérer cette recherche.
Sous cet angle, ce travail assume donc un double rôle. Au-delà de la question principale concernant l’imaginaire catastrophique de la ville, on souhaite contribuer à la définitive entrée du cinéma au sein des objets géographiques. La démarche n’est pas simple. D’un côté, depuis sa naissance, la géographie jouit pour certains, souffre pour d’autres, d’une véritable fluidité épistémologique. Cette fluidité concerne notamment le vrai objet d’étude de la discipline. Le territoire, le rapport entre l’homme et son environnement, les représentations de l’espace, sont tous des éléments qui constituent le noyau de la discipline. Mais la coexistence n’est pas toujours pacifique. Certains revendiquent une unité fondée sur l’hétérogénéité des propos, d’autres préfèrent se barricader dans des courantes différentes (géographie culturelle, géographie physique, géographie sociale, etc.). Certes, il est évident que certaines branches pourront, plus que d’autres, tirer profit du cinéma. Mais tout de même nous ne sommes pas ici pour renforcer les tendances centripètes de la discipline.
Plus que de parler d’un usage du cinéma en géographie, il vaudrait mieux employer le pluriel et parler donc « d’usages ». La question qui anime cette réflexion est donc simple. Quelle place pour le cinéma dans la géographie ? Et encore, en inversant les termes, quelle place pour la géographie dans le cinéma ? Toutefois les réponses que l’on s’efforcera de produire ne doivent pas être considérées comme univoques et moins que jamais définitives. On se trouve encore dans une phase préliminaire, dans laquelle le fait de poser les bonnes questions compte peut-être plus que d’offrir des réponses immédiates. Pour le dire de manière plus simple : le fait que la géographie prenne conscience du rendez-vous manqué ne doit pas générer une sorte de frénésie pour essayer de rattraper le temps perdu. Le but est donc celui de jeter des bases, de fixer un point de départ et de proposer une première approche méthodologique. Si le cinéma doit bien avoir sa place au sein de la géographie, les véritables questionnements doivent concerner le « pourquoi » et le « comment ».
Ici, on souhaite proposer trois usages différents du cinéma dans la géographie. Le premier vise à considérer le film comme une représentation de l’espace. D’un point de vue cinématographique, la référence est aux travaux d’André Bazin (1976), et à son ontologie réaliste, qui considère le cinéma une fenêtre ouverte sur le monde. Cette démarche fait d’un film une image de l’espace et le place donc au même niveau que les autres représentations qui ont déjà fait l’objet de l’attention des géographes. Comme le rappelle Jean-François Staszak, « la géographie, en tant que science sociale, ne s’occupe pas (seulement) du monde tel qu’il est, mais aussi du monde tel qu’il est appréhendé, vécu, et pratiqué. Pour le comprendre, il faut se livrer une analyse géographique des systèmes de représentations, dont témoignent les discours produits par une société donnée » (2014, p. 597). De ce point de vue, la référence pourrait être la carte géographique. Ce qui a été l’instrument de la géographie par excellence, « le substitut le plus exact de la réalité », pour le dire avec les mots de De Martonne (1909), est désormais passé du statut d’outil incontournable à celui d’objet de recherche. La carte continue de jouer un rôle de premier plan dans la géographie, mais son usage ne se limite pas à un fait instrumental. La carte, considérée comme un comme un produit culturel, un témoignage du rapport à l’espace, doté d’une idéologie, d’une sémiotique, se prête à un véritable travail géographique sur son rôle culturel. On est bien loin de la perspective de De Martonne. La carte doit jouer encore son rôle fondateur au sein de la géographie, mais elle doit être considérée dans sa double nature. Le géographe italien Franco Farinelli dans son éloquent La crisi della ragione cartografica, (2009) soulignait le fait que la logique cartographique est constituée par des règles et des lois qui en assurent le fonctionnement. Dans toute forme de représentation, les données réelles doivent se traduire en formes reproductibles. D’où le refus d’un certain positivisme cartographique. Le cinéma comme la carte offre des représentations complexes de l’espace et donc il peut de ce point de vue constituer un objet de recherche pour le géographe.
La deuxième approche considère le cinéma comme un puissant créateur de l’imaginaire spatial. La réflexion ici concernera la nature même de l’espace, considéré comme un objet qui se compose d’une dimension matérielle et d’une dimension immatérielle. Les références concernent notamment le travail de Michel Lussault (2007), qui, en partant de Henri Lefebvre (1974) et de Maurice Godelier (1984) fait de l’espace une entité hybride. L’imaginaire spatial peut être défini comme un patrimoine d’images, représentations, vécus, expériences, qui composent la partie immatérielle de ce dernier. De ce point de vue, un film ne se limite pas à offrir une représentation spatiale, mais il contribue aussi à la création de l’imaginaire, il le fabrique, il concourt à déterminer l’imagerie qui compose la dimension immatérielle d’un lieu. Un film donc concourt, fabrique, compose, mais difficilement peut être considéré, lui seul, comme imaginaire. L’imaginaire d’un espace se compose de manière relationnelle, à travers l’apport des différents types de langage. Le roman, la poésie, la peinture, mais aussi le grand patrimoine d’images audiovisuelles qui ne sont pas forcément fictionnelle. À cela il faut rajouter les différentes expériences personnelles, qui malgré une sorte d’insaisissabilité scientifique, jouent un rôle déterminant. L’imaginaire peut donc se considérer comme une culture de l’espace, un patrimoine hétérogène de savoirs issus de sources différentes. L’approche à l’imaginaire de l’espace nécessite le recours à plusieurs œuvres cinématographiques en cohabitation parfois avec d’autres formes d’expression. Ici, on limitera l’analyse au rôle du cinéma, qui néanmoins, vu l’importance de ce dernier, constitue une des sources majeures.
Cette approche a le mérite d’attribuer au cinéma le statut d’un espace en soi, du moins un espace immatériel. En ce sens le film, en tant que puissant instrument pour la définition d’un imaginaire spatial, sort de sa dimension représentationnelle pour entrer à plein titre au sein de la géographie. En revanche, si Lussault définissait l’espace come hybride (matériel et immatériel), ici on préfère employer le terme de « composite ». Un objet hybride ne permet pas de reconnaître et séparer les entités qui le composent. Au contraire la notion de « composition » permet de pouvoir bien distinguer les différents éléments. Cette précision peut paraître subtile et pointilleuse, mais dans un monde problématique, dominé par une imagerie qui, souvent à tort, compose la quasi-totalité de notre connaissance du réel, il vaut mieux éviter toute confusion. Si l’imaginaire fait partie de l’espace, il ne faut pas non plus mettre sur le même plan un fait qui relève d’une dynamique culturelle avec un autre qui relève d’une réalité matérielle.
La troisième approche vise à considérer un film, non plus comme un objet de recherche, qui soit représentation ou producteur d’imaginaire, mais comme un véritable instrument d’écriture géographique. Dans ce cas le film devient un exemple, une manière pour exprimer concepts et idées en utilisant un langage particulier. L’enjeu ici est considérable tant sur le plan de la recherche que surtout sur celui de l’enseignement. Dans ce cas l’espace filmique sort d’une dimension représentationnelle, ou imaginaire, et devient une sorte de matière conceptuelle exprimant à travers des processus de spatialisation, concepts, théories et idées. L’espace devient alors métaphore, allégorie, symbole de quelque chose d’autre, ou encore texte capable de véhiculer des significations. C’est le cas par exemple du film Bram Stoker’s Dracula (1992), dans lequel Londres et la Transylvanie ne se référent pas à des espaces réels, mais sont des allégories des différentes composantes de la culture victorienne de la fin du XIXème siècle, ou encore le cas de Dogville (2003), dans lequel l’espace se réduit à des lignes blanches dessinées sur le sol. Mais au-delà de deux cas emblématiques, nombreux sont les films qui peuvent être considérés comme une véritable géographique. L’espace filmique, qui soit privé ou pas de toute référence un lieu, est donc susceptible, à travers le langage cinématographique, de devenir une conceptualisation, un discours géographique en soi.
Ces trois approches peuvent fonctionner en autonomie, ou même en cohabitation au sein d’un même film. Vice-versa, il y a des films qui se prêtent bien à une démarche représentationnelle ou à un travail sur l’imaginaire, tandis que certains sont susceptibles d’encourager plusieurs approches. En ayant à faire avec un support riche et complexe comme le cinéma, une certaine flexibilité méthodologique s’impose. D’ailleurs, comme on l’a vu, la géographie est une discipline hétérogène. Il serait donc contreproductif suggérer une manière de procéder standardisée et figée. D’un côté, si tous les films offrent de l’espace, chacun le fait sa manière. De l’autre, le choix d’une approche plus que d’une autre, doit être fonctionnel au type de discours géographique que l’on souhaite mettre en place. Sur ce point il sera nécessaire de réfléchir sur les possibles relations qu’un film peut entretenir avec un lieu ou avec un espace. Un concept clé de la géographie moderne intervient. Il s’agit de la différence entre l’espace, conçu comme catégorie générale et le lieu comme portion d’espace doté d’une signification précise (Massey, Jess, 1995). Ce type de différence est cruciale pour déterminer la portée de la contribution d’un film.
En conclusion, l’espoir est donc de pouvoir considérer ce travail comme une mise au point épistémologique, une manière pour vérifier l’état actuel de la recherche géographique vis-à-vis du cinéma. Les différentes approches méthodologiques ne doivent pas être considérées comme une réponse définitive, mais plutôt comme une boite à outil préliminaire, un exercice capable d’encourager le parcours qui, on espère, marquera la légitimité du cinéma comme objet de la géographie, mais aussi comme géographie en soi.
Structure du travail et corpus d’analyse
Les propos de cette recherche inspirent un travail qui se développera en deux parties composées chacune de quatre chapitres. La première sera consacrée à la mise en place de la réflexion épistémologique et par conséquent à l’élaboration d’une méthodologie qui permettra d’exploiter au mieux l’imaginaire urbain de la catastrophe. Cette partie sera composée de quatre chapitres. Le premier servira à faire le point sur l’état de la recherche dans le domaine des rapports entre cinéma et géographie. Il sera l’occasion de revendiquer le caractère fluide et hétérogène de la géographie, mais surtout sa prédisposition à utiliser le cinéma soit comme objet, soit en tant qu’instrument. Le deuxième constituera la mise en place d’une hypothèse méthodologique. On approfondira les trois approches que l’on vient de décrire plus haut : le cinéma comme représentation de l’espace, comme fabriquant d’imaginaires spatiaux et enfin comme exemple théorique.
Le troisième chapitre se concentrera sur les relations entre l’émergence de la ville moderne et la naissance du cinéma, véritable art urbain. D’abord on proposera un petit rappel historique, visant à relier ces deux phénomènes au sein de l’histoire culturelle du XXème siècle. Ensuite, à l’issue des réflexions précédentes, on essayera de traduire à l’échelle urbaine la grille résultante du couple espace/lieu. On distinguera alors le concept de « ville » comme entité locale, spécifique, dotée d’une identité précise, et celui de « espace urbain » qui se réfère à la dimension générale, symbolique et idéologique. Mais la question terminologique peut s’avérer plus complexe. La différence entre la ville et l’urbain ne relève pas d’un questionnement singulier/général. Michel Lussault dans L’homme spatial (2007) met en évidence le parcours historique qui de la cité, en passant par la ville, mène à l’urbain contemporain. Cette réflexion sémantique prend son sens grâce à l’analyse des mutations qui ont concerné les espaces urbains en particulier à partir du siècle XIXème. En particulier, on essayera de focaliser l’attention sur la crise de l’imagerie urbaine qui découle de ces changements, et le rôle que le cinéma peut assumer dans l’imagerie urbaine contemporaine. Enfin, le dernier chapitre achèvera la partie en proposant des exemples concrets d’analyse géographiques sur le cinéma.
La deuxième partie constituera le véritable noyau de cette recherche. C’est à ce point que l’on abordera d’un point de vue théorique nos propos principaux, c’est-à-dire l’imaginaire urbain de la catastrophe. Dans le détail le premier chapitre proposera une synthétique histoire culturelle des rapports à la catastrophe. Une des références incontournables est constituée par le remarquable ouvrage de François Walter (2008) à propos de la culture des désastres. En particulier on s’efforcera d’argumenter ce que nous allons définir « réalisme dystopique », c’est-à-dire la logique, profondément influencée par une interprétation crisologique, qui anime les relations entre les produits culturels de fiction et les inquiétudes qui hantent la conscience d’un contexte bien défini. Le deuxième chapitre aura en revanche la fonction de décrire au mieux le cinéma des catastrophes. Genre cinématographique ? Filon ? Sous-genre de la science-fiction ? En faisant référence aux études sur les genres au cinéma et plus en particulier sur les anticipations (tant cinématographiques que littéraires), nous essayerons d’établir les rapports entre les images du désastre et une des expression esthético-artistiques les plus prolifiques du XXème siècle. Le troisième se consacrera à la description et à l’analyse du corpus choisi, qui sera partagé en quatre tropes urbains récurrents : l’urbain en destruction ; l’urbain abandonné, contaminé, vidé ou évacué ; l’urbain dystopique ; les restes urbains ou la post-apocalypse. Bien évidemment, au sein de cette analyse nous essayerons de retracer les rapports métaphorique et/ou symboliques qui unissent ces représentations aux pathologies urbaines du siècle. Enfin le dernier chapitre de ce travail essayera d’argumenter une hypothèse fascinante, mais ambitieuse. On va considérer l’imaginaire urbain des catastrophes comme le possible symptôme d’un changement au sein des rapports à l’espace et au temps qui caractérisaient la modernité triomphante.
Pour que ce propos soit accompli, comme on a dit auparavant, il sera nécessaire d’abord réfléchir sur le concept de modernité et sur ses multiples acceptions. En s’approchant aussi du vaste débat lié aux concepts de postmoderne et postmodernisme, on proposera de définir l’imaginaire en question comme une modification, importante mais non radicale, de l’expérience spatio-temporelle à la base de la modernité. Le résultat ne sera pas celui d’un dépassement, ni celle d’une fin définitive de ce que l’on considère ici être la modernité. Au contraire, le néologisme que nous allons employer, la néomodernité, exprime l’impasse qui semble au mieux décrire l’évolution de notre Zeitraumgeist, une évolution qui reste, cependant, pleinement inscrite dans le cadre du sentiment moderne.
Pour ce qui concerne les films-catastrophe, notre corpus de ce travail se compose de soixante-deux œuvres cinématographiques que l’on peut considérer, sous différentes formes, liées à la catastrophe et aux espaces urbains. « Films de catastrophes » est une étiquette vaste, comprenant parfois des œuvres très différentes entre elles. Si ces films peuvent constituer un genre à part entière, cela est une question que l’on préfère laisser aux spécialistes des études à ce propos. Un film considéré comme « de catastrophes » peut très bien être inséré au sein de la science-fiction (par exemple les films aux scénarios de post-apocalypse), en faisant référence à un futur proche ou lointain. D’autres possèdent un caractère d’anticipation assez marqué (ceux qui situent l’événement catastrophique dans notre présent, ou dans un futur très proche). Enfin, on peut avoir des films qui traitent d’événements passés, le plus souvent des histoires vraies. Donc, bien que l’univers de la science-fiction soit la référence dominante, il n’est pas le seul à raconter la catastrophe. Raphaëlle Moine, professeur d’études cinématographiques, définit préalablement le genre cinématographique comme « une catégorie empirique, servant à nommer, distinguer et classer des œuvres, et censée rendre compte d’un ensemble de ressemblances formelles et thématiques entre elles » (2008, p. 7). Dans les différentes typologies de classification que Moine propose, ainsi que dans les sites www.imdb.com et www.allociné.fr, le cinéma de la catastrophe n’apparaît jamais. Il en résulte aussi un discours complexe autour de la notion de genre, de sa fluidité en fonction des contextes culturelles, de ses liaisons avec la longue tradition des études sur les genres littéraires.
Il est évident que dans le cadre d’une recherche sur l’imaginaire urbain, la notion de genre stricto sensu, risquerait de ne pas apporter de contributions productives. Notamment, puisqu’il s’agit ici de traiter les images de la ville au sein d’un groupe de film qui sont parfois très hétérogènes, le concept de genre résulte réductif. Par exemple, un film comme 28 days later, (dont on a décrit une séquence au début), est souvent classé comme film d’horreur, et de même, un des films des catastrophes les plus connus, The Towering Inferno (1974), est classé comme dramatique. D’autres œuvres qui ont marqué l’imaginaire de la catastrophe ces derniers années, comme par exemple 2012, Twelve monkeys (1995), War of the worlds (2005) ou encore The day after tomorrow (2004), sont classés en revanche sous la catégorie de science-fiction.
Quels sont donc les critères qui ont motivé le choix du corpus ? Premièrement, comme il est facile d’imaginer, on s’est concentré sur des œuvres qui racontent une catastrophe ou un désastre. Un événement de ce type peut quand même être évoqué sous des formes différentes. Un film peut se concentrer sur ce qui précède l’événement catastrophique, sans le montrer. Il peut le montrer directement, ainsi que ses conséquences. Enfin la catastrophe peut appartenir au passé diégétique, et donc se limiter à être évoquée comme quelque chose qui a déjà eu lieu (c’est le cas typique des films de post-apocalypse). À cela il faut ajouter toutes les combinaisons possibles entre ces différentes situations temporelles. Bien évidemment, une certaine priorité sera accordée aux films qui se concentrent sur les temps futurs et sur les « présents alternatifs ».
Mais cette considération sera susceptible de comprendre quelques exceptions (qui seront ponctuellement justifiées). L’autre grande critère qui a guidé la sélection des films est la relation avec la ville. Il ne s’agit pas seulement de concentrer l’attention sur des films qui offrent des images de villes subissant une catastrophe. Certains films du corpus par exemple offrent très peu d’images de ce type. En revanche le phénomène urbain peut être évoqué soit comme un espace situé dans l’ailleurs diégétique (un ailleurs qui peut être bien spatial que temporel), soit être présent dans sa dimension idéelle et immatérielle, en relation avec les concepts de civilisation. Enfin, on a essayé de choisir des films capables de soutenir les deux lectures ici proposées : films qui sous différentes formes interrogent les pathologies urbaines du XXème siècle, et films qui sont susceptibles d’exprimer des expériences de l’espace et du temps.
Deux autres questions concernant le corpus méritent d’être éclaircie : provenance géographique et culture de masse. Pour ce qui concerne la première, la plupart des œuvres sont issus de pays occidentaux, et notamment des États-Unis. Les raisons sont multiples. D’un côté, on a dû renoncer à une analyse des films asiatiques, notamment du vaste patrimoine des films catastrophes provenant du Japon. Pour faire cela, on serait obligé de plonger au sein d’une culture orientale complexe et fascinante, mais cela nécessiterait une connaissance préalable des certains aspects constitutifs. Malheureusement, ce n’est pas le cas, et rattraper cette défaillance obligerait à un travail hors de notre portée. De l’autre côté, on remarque qu’une grande partie des films traités provient des États-Unis. Bien que certains films soient issus du milieu indépendant, un grand nombre est de production hollywoodienne. Il s’agit notamment des grands blockbusters, dans lesquels les effets spéciaux jouent souvent un rôle important. En effet, les couts de production élevés ont pour longtemps crée une sorte de monopole hollywoodien. Mais les blockbusters ont parfois le démérite de se concentrer trop sur l’aspect « spectacle » de l’événement catastrophique (Independence day et 2012), et de laisser de côté certains aspects cruciaux pour la réflexion sur l’imaginaire du désastre. C’est moins le cas pour un grand nombre de films européens (mais non seulement) qui seront présents dans notre corpus. Parfois, des ressources économiques limitées, ou sans doute inférieures aux grandes productions américaines, ont eu le mérite indirect de stimuler la créativité de scénarios, en se concentrant sur d’autres aspects que la spectacularisation du désastre.
Le statut culturel des œuvres du corpus mérite un discours à part. Dans ce cas, le choix tend à une certain degré d’indifférence vis-à-vis des questions esthétiques. D’ailleurs, comme on a précisé, ce qui intéresse ici est l’imaginaire de la ville. De ce point de vue, certains films, notamment hollywoodiens, peuvent résulter pauvres. D’autres, au contraire, (notamment certaines petites productions indépendantes), possèdent une certaine relevance esthétique. Mais en considérant l’imaginaire comme un patrimoine d’images médiatiques, il résulte clair que le succès d’un film influe sur son rôle de créateur d’imaginaire. Un film qui a occupé les salles de toutes la planète, au-delà de sa qualité esthétique, aura forcément un impact majeur par rapport un autre dont la diffusion et le succès ont été limités. Un regard particulier sera donc porté vers des films qui font partie de la culture de masse. Sur ce point, la contribution du sociologue Edgar Morin sera utile. Dans son ouvrage L’esprit du temps (sorti en 1962 et réédité en 1975) l’auteur analyse le rôle de la culture de masse au sein de la seconde moitié du XXème siècle. « La culture de masse, qui correspond à l’homme d’un certain état de la technique, de l’industrie, du capitalisme, de la démocratie, de la consommation met aussi cet homme en relation avec l’espace-temps du siècle » (1975, p. 214). Le statut esthétique d’un œuvre cinématographique est totalement indépendant de sa réception, de son succès, ou mieux, de sa relevance au sein de la culture de masse. En plus, souvent, pour répondre aux attentes d’un public toujours plus vaste, aux gouts toujours plus homogènes, les productions se voient contraintes de mettre en évidence certains aspects au profit d’autres. L’accessibilité, le côté spectaculaire, massifié, sont donc des éléments qui deviennent souvent essentiels à la réussite d’une grande production cinématographique. De manière inverse, grâce à cette logique, la culture de masse se prête à une analyse approfondie. On ne s’approche pas d’un film à grand public pour en révéler la valeur artistique, mais pour essayer d’établir son rôle dans la production d’imaginaires, de véhicule d’idéologies qui grâce à ce moyen trouvent l’occasion de se répandre. Pour le dire encore une fois avec les mots d’Edgar Morin, « l’essence communicante et communicative de la culture de masse relaie, relie, médiatise […]. Ainsi, la culture de masse nous introduit dans un rapport déraciné, mobile, errant à l’égard du temps et de l’espace. Ici encore, il y a là une compensation mentale à la vie fixée dans les horaires monotones de l’organisation quotidienne. Mais il y a plus qu’une compensation : il y a une participation au Zeitgeist, Esprit du Temps à la fois superficiel, futile, épique, exaltant. La culture de masse ne se tient pas sur l’épaule du Zeitraumgeist, elle est accrochée à ses basques » (1975, pp. 212-213). Malgré les quatre décennies qui nous séparent de cette affirmation, son actualité semble évidente. Notamment, il est intéressant, dans le cadre de cette recherche, la relation que le sociologue français établit entre la culture de masse et les relations à l’espace et au temps, et pas moins important, le fait de relier ce rapport au Zeitgeist. Il en résulte le fait qu’une grande partie des films présents dans le corpus soient issus de la culture de masse. Il y a bien évidemment des exceptions. En outre, l’appartenance à une culture de grande diffusion n’est pas réservée aux seuls blockbusters. Par exemple, une grande partie de la filmographie sur les Zombies, qui a le mérite d’offrir un imaginaire urbain très intéressant, est issue des productions indépendantes et souvent à faible budget. Cela n’a pas du tout empêché l’entrée de la figure du Zombie au sein des grands mythes de la culture populaire fin XXème siècle.
ce point il reste à voir quelles sont les raisons qui nous ont poussé à élaborer ce type d’agencement du corpus. Une première idée pouvait être celle de partager les films en fonction de la typologie de catastrophe racontée. On aurait pu donc proposer des films dont la catastrophe concerne un événement naturel (séisme, raz-de-marée, éruptions, astéroïdes, etc.), un événement technologique (explosion nucléaire, accidents, pollution, etc.), des épidémies, des invasions extra-terrestres et enfin des catastrophes “sociales” (mondes dystopiques). Mais ce type de classification engendrerait une contrainte importante. Certaines œuvres montrent à ce propos une forte ambiguïté, soit à cause de la coprésence d’événements catastrophiques différents, soit à cause d’un manque totale de renseignements à propos de la vraie nature diégétique du désastre. Pour cette raison, et dans le but de vouloir remarquer encore une fois la géographicité » de ce travail, nous avons opté pour une classification axée sur les paysages urbains de la catastrophe. Ce choix sert aussi à mettre en évidence un aspect de l’imaginaire spatial, qui, comme on a anticipé, n’est pas le résultat d’un seul film, mais plutôt de la concurrence de plusieurs œuvres.
Dans le détail, donc, le trope de l’urbain en destruction comporte des images de destruction matérielles souvent en contemporanéité avec le présent diégétique. Ensuite, dans celui qui concerne l’urbain abandonné, vidé ou contaminé, l’élément dominant sera la présence limitée ou voir l’absence de la population et la fermeture de l’espace urbain. D’un point de vue temporel l’événement catastrophique est proche du présent diégétique. Ensuite ce sera le cas de la dystopie urbaine. Dans ce cas les films montrent des dysfonctionnements urbains radicales comme par exemple excès d’urbanisation, fragmentation, ségrégation, pollution, privatisation, etc. Dans ce cas, il ne faut pas se référer à la catastrophe au premier degré. Il résulte plus correct parler de dystopie, ou de contre-utopie. Enfin, un des tropes sans doute les plus intéressants est celui de restes urbains et de la post-apocalypse qui présuppose que l’événement catastrophique soit généralement antérieur diégétiquement par rapport au présent de la narration.
Table des matières
Introduction
Partie I Cinéma et Géographie
1. Problèmes de situation
1.1. Se situer dans l’espace (de la géographie)
1.2. … Et dans le temps…(un rendez-vous manqué)
1.2.1. Hérodote…Lacoste et Foucher
1.2.2. David Harvey et Mike Davis
1.2.3. La géographie du cinéaste… André Gardies
1.2.4. L’Italie… Un clin d’oeil aux Anglo-Saxons
1.2.5. Actualités francophones
2. Problèmes de théorie
2.1. De la carte au cinéma
2.2. De la représentation à l’imaginaire
2.2.1. L’ontologie réaliste. Le cinéma comme représentation de l’espace –
2.2.2. Le cinéma comme fabriquant d’imaginaires
2.2.3. Le film comme exemple
2.3. Rôle narratif et localisation
3. Le cinéma comme nouveau régime de visibilité de l’urbain
3.1. De la ville à l’urbain… Régimes de visibilité
3.2. Liaisons indissolubles
3.3. Variations sur le thème
4. Alea Iacta Est. À chaque film sa géographie
Une archéologie du présent. Les espaces urbains dans le cinéma-catastrophe
4.1. La ville de l’esprit et la ville du corps. Expressionisme et Néoréalisme
4.2. Gomorra… du film à la série… de la représentation à l’imaginaire
4.3. L’individu dans la métropole… la métropole dans l’individu : Taxi Driver et Bringing out the Dead
Partie II Imaginaires urbains de la catastrophe. De la pathologie à une nouvelle modernité
1. Désastres, catastrophes, catastrophismes. Un Zeitraumgeist crisologique
1.1. Le sentiment de la catastrophe
1.2. Dieux, nature, société
1.3. Le sentiment de la catastrophe à l’âge de l’urbain. Entre Phénoménologie et ontologie
1.4. Le catastrophisme comme réalisme dystopique
2. Le cinéma-catastrophe. Des archéologies du futur à celles du présent
2.1. Les catastrophes au cinéma : un problème de genre
2.2. De la science-fiction à la catastrophe
2.2.1. Introduction. Une genèse spatio-temporelle
2.2.2. La science-fiction comme rapport à l’histoire
2.2.3. La nature du futur. Utopie et dystopie
2.3. Le cinéma-catastrophe comme archéologie du présent
3. Les imaginaires urbains de la catastrophe
3.1. Critères de sélection et classification
3.2. L’urbain en déstruction
3.2.1. Les invasions d’ailleurs
3.2.2. L’imaginaire de l’atome… (pendant l’atome)
3.2.3. Ecocydes
3.3. L’urbain contaminé, vidé, évacué, fermé
3.3.1. Variations réalistes
3.3.2. L’urbain zombifié. La puissance des métaphores et des allégories—
3.3.3. 28 Days Later… Le Triomphe de l’imaginaire
3.3.4. Quelques variations sur le thème : 28 Weeks Later, Le Temps du Loup, The Happening et 12 Monkeys
3.4. L’urbain excéssif
3.4.1. De Metropolis à In Time
3.5. L’urbain en ruine… Les paysages du post…
3.5.1. Variations sur le thème de l’atome. On the beach, The Divide, La Terre Outragée
3.5.2. Requiem pour l’urbain…The Road
4. Archéologie du présent. Les imaginaires des catastrophes comme signe d’une nouvelle modernité ?
4.1. La modernité comme Zeitraumgeist
4.2. Le Zeitraumgeist expliqué par Coppola
4.2.1. Fidélités et infidélités… du roman au film
4.2.2. La Transylvanie
4.2.3. Londres, l’Angleterre, le monde Occidental
4.2.4. Un espace-temps dialectique
4.2.5. La modernité comme expérience dialectique
4.3. Le problème du Post
4.4. Vers une nouvelle modernité spatio-temporelle ?
4.4.1. Les Terminators comme paradigme temporel d’une nouvelle modernité
4.4.2. La métropole des lumières… Los Angeles par Michael Mann
4.5. Une conclusion déictique. L’expérience néomoderne
Conclusion
Bibliographie
Filmographie
Télécharger le rapport complet