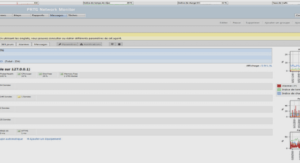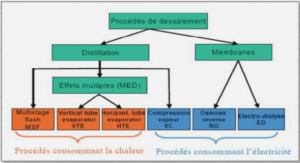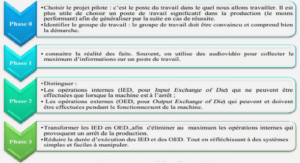Le paternalisme esclavagiste dans la colonie du Cap
À l’analyse de l’esclavage dans la colonie du Cap, de quel côté qu’on le prenne (mentalités et idéologies, violences, résistances, esclavage au quotidien, statut du travail des esclaves, etc.), il est difficile de mettre de côté l’un de ses éléments qui apparaît aux yeux des historien.ne.s parmi les plus remarquables. Il s’agit du thème du « paternalisme » des employeur.se.s, c’est-à-dire la propension de ces dernier.e.s à définir les esclaves comme leur propriété. Ce paternalisme est un discours servant idéologiquement à asseoir l’institution esclavagiste : il approfondit un rapport de pouvoir concret – l’appropriation de corps réduits à un statut héréditaire de main-d’œuvre servile – aussi bien qu’il en résulte. Au moment de l’abolition de l’esclavage dans la colonie, la mobilisation renouvelée de ce paternalisme des employeur.se.s montre bien leur tentative de faire persister ces rapports de pouvoir malgré cette abolition officielle.
La sédimentation de ce paternalisme est ancienne. La colonisation de peuplement dans la colonie du Cap, qui débute en 1657 avec les premiers octrois de terres, se fonde sur la propriété des esclaves qui commencent à être déporté.e.s vers le port du Cap dès l’année suivante. Très vite, le contrôle des esclaves repose alors sur la conception de l’esclave comme lijfeigene (littéralement «propriété-corps»), comme faisant partie intégrante de la famille de l’employeur.se. Ce qui est en jeu dans le paternalisme est la conception des fermier.e.s blanc.he.s néerlandophones d’une sphère privée non pas définie par la famille nucléaire mais par le foyer.
Mais ce paternalisme est avant-tout mobilisé par les propriétaires d’esclaves de genre masculin, et par leurs fils, dans la mesure où le foyer est organisé selon une distribution patriarcale des rôles et des pouvoirs à la ferme. Par exemple, une femme néerlandophone ne pourra être propriétaire d’esclaves qu’en vertu d’un éventuel veuvage. Le paternalisme esclavagiste de la colonie du Cap est donc paradoxalement exclusif, bien qu’il repose sur un discours prônant une large intégration des individu.e.s (esclaves inclus.es) à la sphère privée. C’est que l’intégration à un espace n’interdit pas la structuration de rapports hiérarchiques en son sein. Les rapports de pouvoir raciaux, esclavagistes et de genre sont les plus manifestes. De cette manière, le paternalisme est aussi une idéologie inclusive pour les propriétaires d’esclaves puisqu’il leur permet de reconnaître leur statut entre eux et, avec cet appui collectif, l’imposer aux autres. C’est pourquoi il est possible de parler d’une certaine cohésion culturelle entre ces propriétaires, surtout à partir de la fin du XVIIIe siècle, soudant une élite rurale à l’échelle locale à partir de l’économie esclavagiste. Cela donne lieu à des stratégies matrimoniales de remariages endogames, ainsi qu’à l’existence de prêts monétaires informels entre propriétaires. Wayne Dooling, auteur d’un ouvrage sur cette question de la cohésion culturelle entre propriétaires, la nomme «hégémonie morale». Elle est morale, en effet, dans le sens où le statut social d’un propriétaire dépend de la gestion respectable de ses esclaves, c’est-à-dire de la perception par ses pairs de celle-ci .
Les changements apportés par les Britanniques avant l’abolition de l’esclavage
C’est cette tradition historique du paternalisme qui est principalement remise en cause avec l’abolition de l’esclavage par les Britanniques – même si, en réaction, cette tradition est remobilisée avec acuité par les propriétaires. Les Britanniques occupent militairement la colonie dès 1795, pendant les guerres napoléoniennes, avant qu’elle ne soit administrativement intégrée de manière pérenne à l’Empire britannique en 1806. L’abolition de la traite, décidée l’année suivante et appliquée dans l’ensemble de l’Empire (à l’exception des Indes), succède donc presque immédiatement à cette installation dans la colonie du Cap. Comme nous venons de le mentionner, elle renforce le caractère idéologique de la maternité au sein du système esclavagiste. Elle ouvre également la perspective de l’abolition de l’esclavage, dont la date et les modalités sont alors en débat mais encore inconnues à Londres. Dans les faits, cette abolition se fera de manière progressive. Tout d’abord trois « lois de réforme » de l’esclavage sont mises en place dans les années 1820, avant la perspective de l’abolition définitive. En 1823, le gouverneur de la colonie du Cap, Lord Charles Somerset, proclame la reconnaissance légale du mariage des esclaves, aux seules conditions qu’ils et elles soient chrétien.ne.s (baptisé.e.s) et que leur propriétaire ait donné son aval. Ce dernier point est important, puisque deux esclaves dont le mariage est légalement reconnu ne peuvent plus être séparé.e.s par la vente du mari ou de la femme hors de la ferme de leur propriétaire. Avec cette proclamation de 1823, la séparation des mères et des enfants est toutefois rendue plus aisée pour les propriétaires puisque les enfants chrétien.ne.s de plus de dix ans peuvent désormais être revendu.e.s ailleurs (contre, généralement, plus de seize ans dans les autres colonies de l’Empire britannique). Le successeur par intérim du gouverneur Somerset, Richard Bourke, introduit dès son entrée en fonction (en 1826) l’ordonnance 19 , qui ne revient pas sur les dispositions de 1823, tout en les élargissant : les enfants de moins de dix ans et leur mère sont toujours protégé.e.s contre leur séparation, qu’ils ou elles soient chrétien.ne.s ou non. Il en va de même pour les mariages entre esclaves non-chrétien.ne.s, maintenant reconnus. Surtout, la nouveauté qu’apporte l’ordonnance 19 est que les esclaves peuvent défendre eux-mêmes et elles-mêmes ces droits protégeant leur famille devant l’institution du «Gardien des esclaves». Mais comme l’autorisation du propriétaire est toujours nécessaire, le «Gardien des esclaves» n’a alors tendance à ne donner raison (contre la séparation familiale) qu’aux époux d’un même propriétaire. Les possibilités effectives de mariages sont faibles. Ces deux premières réformes des années 1820, qui protègent essentiellement les mères et leurs enfants contre leur séparation, renforcent donc la structure matrifocale de la famille d’esclaves. Quant à la troisième et dernière réforme, l’ordonnance dite « consolidée » (consolidated ordinance) de 1830, elle corrige ce travers en abolissant la nécessité de l’accord du ou des propriétaire(s) pour la reconnaissance d’un mariage.
La période d’« apprentissage »
La période de l’«apprentissage» vient confirmer ces tendances : la confrontation des paternalismes des employeur.se.s et des philanthropes, la convergence des statuts d’ex-esclaves (devenu.e.s apprenti.e.s) et de travailleur.se.s dépendant.e.s, la confirmation que l’abolition de l’esclavage n’est pas contradictoire avant la permanence d’une servitude de la main-d’œuvre.
L’un des gages offerts par la Couronne britannique aux propriétaires d’esclaves reste l’indemnisation en espèces de chacun.e de leurs esclaves, dont, techniquement, l’administration britannique « rachète » la liberté. Les apprenti.e.s ne bénéficient d’aucune liberté de mouvement et
ne sont pas rémunéré.e.s par leur employeur.se (leur ancien.ne maître.sse) malgré l’idée initiale de l’abolition, formulée en métropole, que les « apprenti.e.s » devaient devenir de futur.e.s salarié.e.s formé.e.s à la maîtrise d’un métier. De fait, l’apprentissage n’abolit pas grand-chose pour les ex-esclaves, à une exception notable : l’apprentissage permet aux apprenti.e.s de porter plainte devant une magistrature dite « spéciale » (car créée ad hoc et devant disparaître à la fin de la période d’apprentissage) contre leur employeur.se. Ce.tte dernier.e, à l’inverse, peut également porter plainte contre l’un.e de ses apprenti.e.s. Les magistrats, eux aussi dits « spéciaux » (Special Magistrates), des hommes britanniques rémunérés par la Couronne, sont nommés depuis Londres. Ce qu’on demande à ces magistrats, pour l’essentiel des militaires, est d’être totalement étrangers à la colonie dans laquelle ils interviennent, afin d’éviter les conflits d’intérêts – l’administration locale des colonies esclavagistes voyant d’un mauvais œil l’abolition de l’esclavage. Néanmoins, la magistrature spéciale s’inspire de l’institution du « Gardien des esclaves » et des resident magistrates (auparavant landdrosts et heemraden) des années 1820 et du début des années 1830. Les fonctions du magistrat spécial sont multiples : il gère les prisons et la police locale (parfois créée à l’occasion de l’apprentissage), arbitre les mises en apprentissage des enfants des ex-esclaves «engagé.e.s» par l’employeur.se de ces dernier.e.s, juge les dépôts de plainte des apprenti.e.s et des employeur.se.s, effectue la procédure des dédommagements des ex propriétaires et supervise les demandes de rachat de liberté (lorsque des «apprenti.e.s» souhaitent s’affranchir de leur apprentissage). Enfin, il lui est requis de visiter les fermes dans lesquelles travaillent au moins vingt apprenti.e.s, dans le but d’y récolter d’éventuelles plaintes. Londres décide de n’envoyer que huit magistrats spéciaux dans la colonie du Cap, soit un seul par district. Ils sont aussi nombreux que sur l’île de Barbade, ce qui illustre la difficulté particulière qu’ont les magistrats spéciaux de la colonie du Cap à recueillir efficacement les plaintes tant les distances à parcourir pour les plaignant.e.s y sont grandes. Les magistrats spéciaux, par manque de moyens et à cause des grandes distances, dépendent de la générosité et de l’hospitalité des propriétaires d’esclaves, si bien qu’ils ne sont pas toujours rétifs aux traitements de faveur.
Le difficile aboutissement des plaintes des apprenti.e.s
Le nombre de plaintes est donc inégal : sur 561 jugements, 404 sont issus de plaintes déposées par des employeur.se.s, contre 157 par des apprenti.e.s. Mais nombre de plaintes d’apprenti.e.s passent à la trappe. C’est le cas des nombreux dépôts de plainte que le magistrat spécial décide tout simplement d’enterrer, sans que l’on ne puisse savoir pour quelles raisons, si ce n’est que ces refus se font toujours à l’encontre des plaintes des apprenti.e.s, pas des employeur.se.s . Mais les plaintes qui sont acceptées par le magistrat spécial ont également du mal à aboutir à un jugement, car entre le moment du dépôt de la plainte d’un.e apprenti.e et le jugement (qui sont séparés pour assigner les témoins et l’accusé.e à comparaître), beaucoup de choses peuvent se passer. Dont notamment les pressions des employeur.se.s, probables quand l’on observe toutes ces plaintes se soldant par un échec par absence de témoins. Eva, qui est partie se plaindre le 20 mars 1835 accompagnée de Sarah, une autre apprentie et sa témoin pour le jugement, se retrouve quelques semaines plus tard seule face à son employeur et face au magistrat spécial. Le magistrat retire la plainte, et passe totalement sous silence le caractère légalement impératif des assignations à comparaître qu’il ordonne (c’est-à-dire que la présence d’un.e témoin assigné.e à comparaître n’est théoriquement pas facultative) . Le magistrat spécial ne fait absolument rien contre ces pressions, bien qu’il ait les moyens de faire venir les témoins. Une exception qui confirme la règle implicite (d’après laquelle les assignations à comparaître ne sont pas coercitives) souligne en miroir le laxisme de Thomas Ladd Peake. Il prévient avec courtoisie par courrier Isaac Schalk van der Merwe Senior – l’ex-propriétaire des 52 esclaves – qu’il lui envoie Camies Fortune, un agent de police, chercher Lea pour qu’elle puisse comparaître devant lui (en dépit de la volonté de son employeur, a priori) . Les pressions sont telles que les plaignant.e.s eux-mêmes ou elles-mêmes retirent leur plainte ou, ce qui est une conséquence de la relation d’entretien propre à l’apprentissage (une relation de dépendance individuelle), arrivent à un « compromis » avec leur employeur.se – ce qui n’arrive bien évidemment jamais lorsque les employeur.se.s sont à l’origine de la plainte .
Une violence physique justifiée par le magistrat spécial
Le terme de violence à l’encontre des apprenti.e.s n’a rien d’une exagération. La flagellation à coups de fouet, de cravache, de bâton ou encore de sjambock attaque jusque la chair.
Les coups de cravache laissent des cicatrices aux jambes de Sarina qui sont toujours parfaitement visibles plus de trois mois après les faits. Jephta, quand à lui, porte sur son dos toute la violence d’une transition post-esclavagiste. L’esclavage reste un lourd fardeau. C’est ce qu’indique l’agent de police, Thomas Sams, quand il affirme au printemps 1835 que la plupart des cicatrices dans le dos de l’apprenti sont anciennes, même si d’autres plus « fraîches » se sont ajoutées. Les cicatrices sont des signes que tout le monde peut lire, un fardeau à porter qui agit aussi sur les autres apprenti.e.s comme une menace . Le passé esclavagiste n’est pas effacé par le présent de l’apprentissage ; ce dernier ne fait qu’écrire par-dessus. Ce dernier exemple souligne également que les marques des violences ne peuvent être une preuve de violences physiques que lorsqu’un Européen et agent de police local, généralement William de Jong, affirment qu’elles le sont . Le cas de Jephta, enfin, est une bonne illustration des plaintes que déposent les apprenti.e.s : elles sont toujours concentrées sur un fait (de violences physiques, surtout) qui a un caractère ponctuel. Contrairement aux employeur.se.s qui portent plainte contre l’insolence, la désobéissance, etc. systématiques, presque essentialisées, de leurs apprenti.e.s, certain.e.s apprenti.e.s écartent eux-mêmes ou elles-mêmes d’autres violences physiques qu’ils ou elles ont subies pour que leur plainte précise ait toutes les chances d’aboutir . Ce différentiel est une tactique de la part des apprenti.e.s et des employeur.se.s, qui tou.te.s deux connaissent bien le rapport de force dans la magistrature spéciale, qui se trouve être à leur désavantage ou à leur avantage selon leur statut social.
Table des matières
Introduction
I. Contexte
A. Le paternalisme esclavagiste dans la colonie du Cap
B. Les changements apportés par les Britanniques avant l’abolition de l’esclavage
C. La période d’« apprentissage »
II. Présentation des sources
III. Partis pris historiographiques
A. Débats historiographiques sud-africains
B. Les acquis de l’histoire sociale
Première partie. Les structures sociales de l’apprentissage
I. Une économie esclavagiste
A. Des fermes organisées par l’exploitation esclavagiste
1. La répartition de la population
Tableau 1 : Nombre d’esclaves par propriétaire selon la région
Tableau 2 : Évolution de la population de Worcester
2. L’apprenti.e, encore et toujours une marchandise
B. Une économie pastorale en cours d’intégration au commerce mondial
1. La production de la laine
Tableau 3 : Évolution des cheptels à Worcester
2. Le commerce de la laine
II. Entre apprentissage et engagisme
A. La mise sous tutelle des enfants
Tableau 4 : Commentaires du magistrat concernant la mise en apprentissage des enfants
B. Une dépendance commune : l’entretien comme rémunération
III. Matrifocalité et division sexuée du travail
A. Division sexuée du travail
B. Matrifocalité
Deuxième partie. Violences et résistances
I. Les moyens du contrôle social de la main-d’œuvre
A. La magistrature spéciale : une institution favorable aux employeur.se.s
1. La magistrature spéciale à Worcester
2. Le difficile aboutissement des plaintes des apprenti.e.s
B. La violence physique comme contrôle social
1. Une violence patriarcale
2. Une violence physique justifiée par le magistrat spécial
3. Les peines de coup fouet : la flagellation d’État
C. Prison, travail forcé et remise au travail
1. Les peines d’emprisonnement
Tableau 1 : Condamnations rendues par le magistrat contre les employeur.se.s
2. Le travail forcé
Tableau 2 : motifs des 103 plaintes déposées contre les apprenties
Tableau 3 : motifs des 301 plaintes déposées contre les apprentis
Tableau 4 : Peines infligées aux apprenties (113 condamnations)
Tableau 5 : Peines infligées aux apprentis (312 condamnations)
II. La résistance des apprenti.e.s contre la théorie du « consentement »
A. Les résistances individuelles par le travail
B. Marcher sur de grandes distances
C. S’arroger le droit à la parole
1. Le mutisme imposé des apprenti.e.s
2. La prise de parole comme désaveu d’un « consentement » imposé
Troisième partie. Les « économies morales » de l’apprentissage
I. La formation de la sphère privée
A. La notion d’« économies morales »
B. Textes publics, textes masqués et tactiques des apprenti.e.s
C. Le privé selon l’administration britannique : une tactique de colonisation ouvrant la porte à une connivence des employeur.se.s
D. Le privé selon les employeur.se.s : le Grand Trek comme symptôme
II. Les « économies morales » du travail
A. Le travail comme expérience limite
1. L’astreinte au travail jusqu’à la limite du tolérable pour les apprenti.e.s.
2. L’insubordination au travail jusqu’à la limite de l’admissible selon les dominant.e.s
B. La non-homogénéité des intérêts des dominant.e.s et des apprenti.e.s
1. Une économie morale du travail commune qui masque les rapports de pouvoir entre
Européen.ne.s
2. Une culture subalterne de la résistance des apprenti.e.s était-elle possible ?
Conclusion
Sources
Table et sources des cartes
Bibliographie