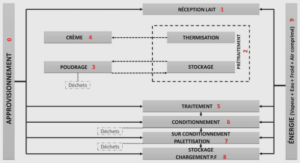Les performances commerciales globales des pays d’Afrique subsaharienne sont médiocres et évoluent au gré des variations des prix des matières premières agricoles et minérales. Nous étudions donc la composition des exportations des pays choisis pour notre étude tant pour comprendre les effets de la spécialisation sectorielle que pour essayer d’expliquer les grandes différences de performances entre pays. Pour ce dernier point, nous recourons à un indicateur qui nous permet de distinguer entre effet sectoriel et effet de compétitivité.
Prédominance des biens primaires au niveau des exportations
Alors que les autres régions en développement se sont désengagées des marchés des produits primaires, la part des recettes à l’exportation des pays africains provenant des exportations des matières premières minérales et agricoles est largement supérieure à la moyenne mondiale .
Notons, cependant, que la situation varie beaucoup entre les différents pays d’Afrique subsaharienne . Il est vrai que pour les pays d’Afrique de l’Ouest étudiés, la part des produits du secteur primaire dans les exportations varie entre plus de 50 % et quasiment 90 % en 1999. A l’exception du Nigeria, dont plus de 80 % des exportations sont représentées par les produits pétroliers, il s’agit avant tout de produits agricoles vendus tels quels ou légèrement transformés, comme c’est le cas pour le Sénégal avec la vente de poissons congelés ou frits. Dans cette région, seules les exportations du Ghana incluent une part importante de biens manufacturés (un peu moins de 50 % des exportations totales en 1999). L’ensemble des pays de l’Afrique australe, quant à eux, présentent une structure sectorielle des exportations différente de celles des pays d’Afrique de l’Ouest étudiés précédemment. Elles comprennent davantage de biens transformés. Maurice exporte surtout des biens manufacturés puisque ces derniers représentent les trois-quarts de ses exportations totales. Les exportations malgaches sont dominées, elles aussi, par les produits industriels (55 %). Cette part est largement supérieure à celle des biens agricoles (28 %). Les exportations de l’Afrique du Sud sont constituées pour moitié par des biens de simple transformation et des biens manufacturés.
Ainsi, une analyse par pays de la structure sectorielle des exportations nous amène à distinguer deux cas de figure suivant la part occupée par les produits industriels avec le Ghana en position intermédiaire. Cette typologie oppose en l’occurrence pays de l’Afrique de l’Ouest et pays de l’Afrique australe. Une comparaison des structures des exportations de ces économies avec celles des pays qui sont parvenus à une meilleure insertion internationale permet de mettre en relief la spécificité de la spécialisation des pays de l’Afrique de l’Ouest . Même si les produits primaires et de transformation occupent une part importante du total des exportations marocaines et chiliennes, nos quatre pays de comparaison (Chili, Malaisie, Maroc, Tunisie) s’avèrent exporter en grande majorité des produits industriels.
Pour analyser plus finement la structure des exportations des pays de l’Afrique subsaharienne tout en corrigeant les effets d’un manque général de compétitivité de ces économies, nous utilisons la méthode des « avantages comparatifs révélés» (ACR). Cette méthode permet de déterminer la contribution de chaque produit (ou de chaque groupe de produits dans le cadre de cette étude) à la balance commerciale du pays considéré(15) . Les graphiques suivants présentent les calculs effectués par l’International Trade Center. Ils ont été effectués à partir du regroupement des, produits en 34 groupes dont la définition détaillée est présentée en annexe 2. L’ACR s’interprète par rapport à son signe : s’il est positif pour un produit ou groupe de produits, celui-ci contribue fortement aux exportations du pays ; a contrario, un ACR négatif traduit le fait que le produit ou groupe de produits considéré est très peu exporté, et peut même être importé en quasi totalité.
Nous avons mis en évidence, dans les graphiques suivants, les cinq groupes de produits pour lesquels l’avantage comparatif révélé enregistrait la valeur la plus élevée, pour l’exportation desquels les pays ont un avantage certain. Nous avons aussi ajouté les cinq produits pour lesquels les économies nationales détiennent les désavantages comparatifs révélés les plus forts. Les graphiques mettent en évidence que la plupart des pays d’Afrique subsaharienne détiennent des avantages comparatifs révélés pour les produits primaires. Les désavantages comparatifs observés de cette région, à savoir les produits manufacturés (les machines non électriques, les équipements de transports) sont communs à l’ensemble du continent. On ne retrouve pas dans les avantages comparatifs révélés de l’Afrique du Sud la prépondérance des produits agricoles, mais plutôt celle des industries exploitant les produits miniers (aurifères). Ceux de la Côte d’Ivoire sont(13)les productions de cacao et de café. Pour le Sénégal, il s’agit des produits halieutiques, des produits pétroliers pour le Nigeria et du cacao pour le Ghana. Maurice a un avantage comparatif révélé important dans le secteur du textile mais aussi sur les productions traditionnelles, à savoir essentiellement le sucre. Par ailleurs, même si l’économie malgache est toujours dominée par l’exportation de produits primaires (café, sucre ou encore produits halieutiques), le textile tend à devenir un avantage comparatif révélé en raison de sa contribution de plus en plus élevée aux exportations malgaches. Notons, cependant, que les données miroirs utilisées dans notre étude ne permettent pas de saisir les flux de commerce entre pays africains. Le peu de produits manufacturés exportés par les pays subsahariens le sont surtout à destination des autres pays de la région, et ne peuvent donc pas être pris en compte. Par voie de conséquence, les échanges des produits plus transformés sont sous-estimés.
Une spécialisation à faible chance de croissance
Selon la théorie traditionnelle de Heckscher-Ohlin, les pays exportent les biens qui utilisent de façon intensive les facteurs de production pour lesquels ils sont les plus abondamment dotés et importent les produits qui utilisent les intrants les plus rares sur le territoire. Ainsi, les différences de ratio (exportations de biens manufacturés / exportations de biens primaires) entre les diverses régions du monde se justifieraient par le rapport (capital physique et humain / ressources naturelles).
Concernant les pays africains, un ratio très faible expliquerait la part prépondérante des biens primaires dans leurs exportations. De plus, la théorie classique du commerce international enseigne que les pays doivent accorder la priorité à l’exploitation de leurs avantages comparatifs.
En l’occurrence, il s’agirait pour l’Afrique subsaharienne d’approfondir sa spécialisation sur les produits agricoles et d’extraction minière.
Ceci n’est pas sans inconvénient compte tenu de la structure actuelle des échanges mondiaux. En effet, selon la thèse de Prebisch (1950) et de Singer (1950), les produits primaires ne présentent pas de grandes perspectives de développement et de croissance. Ces deux auteurs appréhendent ce phénomène en comparant l’évolution des prix relatifs des biens. Depuis les théories classiques, on admettait que, sur le long terme, les prix des produits agricoles avaient tendance à monter relativement à ceux des biens industriels en raison de la rareté naturelle des ressources du sol et du sous-sol. Selon Prebisch et Singer, en revanche, il existe une tendance séculaire à la dégradation des termes de l’échange des produits primaires. Les effets du progrès technique sur les prix des différents produits peuvent être différents selon le niveau de développement : dans les pays industrialisés, les structures de marché sont moins concurrentielles que dans les États moins avancés (les profits se partagent entre un faible nombre de grandes firmes et les syndicats empêchent l’atomisation du marché du travail), si bien que les prix ne baissent pas dans la même proportion que dans les pays moins développés. Singer ajoute une explication par la demande en soulignant la faible élasticité revenu des produits primaires .
D’une part, la demande des produits alimentaires augmente moins vite que le revenu. D’autre part, si on prend en compte les effets du progrès technique, l’absorption des matières premières, en tant que bien intermédiaire, par unité de produit industriel tendrait à se réduire en raison des différentiels de croissance entre ces deux catégories de produits, mais aussi du développement de la production de produits de synthèse voués à se substituer aux produits naturels. Ces facteurs font que la plupart des produits de base souffrent d’une infériorité fondamentale par rapport aux biens manufacturés au regard de la demande. Sans aller jusqu’à évaluer la demande mondiale de produits agricoles, ce qui nous éloignerait du thème des performances commerciales, nous pouvons nous fonder sur l’évolution de la composition des échanges de bien pour évaluer l’hypothèse d’infériorité des biens primaires. De fait, le niveau et l’évolution de la demande internationale varient beaucoup d’un produit à l’autre.
Introduction |