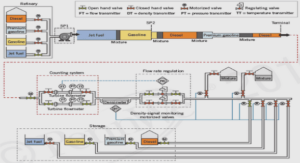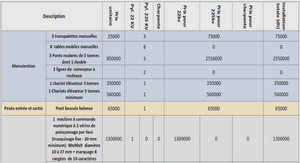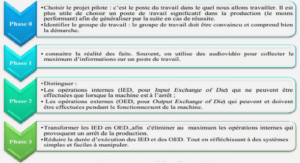Programmes d’études au Canada, tutoriel & guide de travaux pratiques en pdf.
L’année d’arrivée au Québec et la catégorie d’immigration
La grande majorité des répondants qui ont participé à cette étude sont arrivés au Québec à partir des années 2000, soit 19 répondants sur 24, correspondant à 70,8% du total. Parmi ces derniers, sept répondants ont immigré au Québec entre 2000 et 2004, sept entre 2005 et 2009 et cinq entre 2010 et 2012. Pour ce qui est des autres vagues d’immigration, trois ont immigré au début des années 1990 (entre 1991 et 1993), une en 1983 et une en 1970.
Mis à part trois répondants qui ont immigré grâce au regroupement familial et une étudiante étrangère, tous les autres répondants qui sont arrivés dans les années 2000 ont été admis au Canada en tant que travailleurs qualifiés, soit 15 répondants sur 19. Ce constat reflète bien la réalité actuelle au plan provincial, puisque la majorité des nouveaux immigrants accueillis récemment au Québec appartiennent à cette catégorie. En 2014, par exemple, 57,7% des immigrants admis au Québec étaient des travailleurs qualifiés (MIDI, 2015a).
Les trois répondants arrivés au début des années 1990 ont tous été reçus en tant que réfugiés. En raison de la situation sociopolitique précaire qui avait cours au Pérou dans les années 1990 (avec la violence liée aux affrontements entre l’État et les guérillas du Sentier lumineux, notamment), il n’est pas surprenant que ce soit uniquement durant cette période que l’on retrouve les trois seuls participants qui ont été admis en tant que réfugiés. D’ailleurs, la période 1991-1992 a connu un boom de réfugiés péruviens avec l’admission de 406 demandeurs d’asile en provenance du Pérou durant ces deux années (Québec, ministère de l’Immigration et des communautés culturelles, 2009, cité dans Charbonneau, 2011 : 50). Enfin, la répondante arrivée en 1970 a été reçue au pays parce qu’elle avait épousé un homme d’origine française qui avait immigré au Québec. Elle a donc été incluse dans la catégorie du regroupement familial aux fins de cette étude.
Figure 5 : La période d’arrivée au Québec et la catégorie d’immigration des répondants (N=24)
Note : Le statut d’étudiante étrangère ne correspond pas à une catégorie d’immigration, puisqu’il s’agit d’un statut de résidente temporaire aux fins d’études. J’ai tout de même inclus cette personne dans cette enquête (voir l’explication ci-dessous).
Notons que j’ai aussi inclus une entrevue avec une étudiante étrangère (Sofia), arrivée en 2010. Bien que cette dernière ne fût pas une immigrante reçue, j’ai trouvé que son expérience était très pertinente. Bien sûr, contrairement aux autres immigrants, elle n’a pas eu à se chercher un emploi puisque son séjour n’était que temporaire. Comme je n’avais pas précisé que j’excluais les étudiants étrangers dans mon annonce de recrutement, j’ai tout de même fait l’entrevue avec elle. Comme il s’agit d’une étude à caractère qualitatif – qui s’intéresse aux questions d’identité et d’adaptation, d’une part et qui, d’autre part, priorise la diversité des parcours – j’ai finalement décidé de garder son témoignage pour cette recherche.
Le dernier diplôme obtenu et l’occupation
La majorité des Péruviens qui ont participé à cette étude possédait un diplôme d’éducation postsecondaire, soit 22 personnes sur 24. Parmi ces derniers, un répondant détenait un diplôme collégial, 13 répondants détenaient un baccalauréat, sept une maîtrise et une personne avait un doctorat. Le tableau 2 présente la répartition des répondants selon le dernier diplôme obtenu.
Tableau 2 : Répartition des répondants selon le dernier diplôme obtenu (N=24)
Malgré leur niveau d’éducation élevé, plusieurs des répondants interrogés occupaient un emploi en deçà de leurs qualifications. Parmi les 21 répondants qui occupaient un emploi au Québec au moment de l’entrevue (l’éducatrice retraitée, l’étudiante et la mère à la maison ont été exclues de ces calculs), 16 d’entre eux étaient en situation de sous-emploi, c’est-à-dire qu’ils étaient surqualifiés pour l’emploi qu’ils avaient. Seuls les deux répondants détenant un diplôme d’études secondaires, ainsi que trois titulaires d’un baccalauréat, avaient un emploi qui correspondait à leur niveau d’études. Le tableau suivant illustre cette réalité en comparant le diplôme obtenu par rapport au diplôme requis pour le travail des répondants. Notons que l’ensemble des détenteurs d’un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle (maîtrise ou doctorat) étaient surqualifiés pour leur emploi au moment de l’entrevue.
Tableau 3 : Diplôme obtenu par rapport à l’emploi occupé (n=21)
Résumons les caractéristiques de notre échantillon. En bref, la majorité des participants interrogés dans le cadre de cette étude (22 sur 24) étaient âgés de 34 à 56 ans. À Montréal, plus d’hommes ont participé aux entrevues, alors qu’à Québec, plus de femmes ont pris part aux entretiens. Environ 60 % des répondants (15 sur 24) sont arrivés au Québec à partir des années 2000 en tant que travailleurs qualifiés et la plupart détenait un diplôme universitaire (21 sur 24). Il s’agit donc d’un groupe de personnes éduquées pour la grande majorité. Malgré leur haut niveau d’éducation, les trois quarts des personnes interrogées qui travaillaient étaient en situation de sous-emploi. Attardons-nous maintenant aux raisons qui ont motivé les immigrants péruviens à quitter leur pays.
À la recherche d’un monde meilleur
Prendre la décision de quitter son pays pour s’établir dans un autre endroit n’est jamais un choix facile. En fait, s’agit-il vraiment d’un choix ? La réponse varie selon chaque personne qui entreprend un processus migratoire. Pour les réfugiés qui ont quitté le Pérou dans les années 1980 et 1990 durant la période du conflit armé, la question du choix se pose moins. José, arrivé en 1993, ainsi que Manuel et Andrea, arrivés en 1991, ont tous les trois demandé et obtenu le statut de réfugié au Canada parce qu’ils considéraient que leur vie était en danger au Pérou. Rester au Pérou n’était plus une option pour eux. José, par exemple, était caméraman pour une chaîne de télévision nationale et il avait été pris en otage à quelques reprises à bord de son camion alors qu’il travaillait. Chaque jour, il sentait qu’il risquait sa vie pour accomplir son travail. Il a donc fait une demande d’asile au Canada. Hésitant entre les États-Unis et le Canada, il a choisi ce dernier pays parce qu’il avait la possibilité de faire une demande d’immigration légale et d’obtenir ainsi le statut de réfugié. Hormis José, Manuel et Andrea, qui ont obtenu le statut de réfugié au début des années 1990 (et Sofia, qui était étudiante étrangère), tous les autres participants à cette étude ont été admis de manière permanente au Canada comme travailleurs qualifiés ou dans le cadre d’une réunification familiale. Pour la plupart de ces migrants, la décision de quitter le Pérou a davantage été prise dans une perspective d’amélioration de leurs conditions de vie et de travail.
L’insécurité
Lorsque j’ai demandé aux participants de la recherche pourquoi ils avaient décidé de quitter le Pérou, la grande majorité d’entre eux ont d’abord mentionné l’insécurité qui prévalait dans leur pays d’origine, que ce soit pendant ou après la période du conflit armé péruvien22. Ceux qui sont arrivés comme réfugiés dans les années 1990 ont mentionné que la violence liée au conflit armé mettait directement leur vie en danger. Pour les autres, arrivés à partir des années 2000, soit après la période du conflit armé, la sécurité constituait également une raison importante pour quitter le Pérou. La peur constante de se faire voler, d’être victime d’un secuestro expresso (kidnapping express)23 ou de violence quelconque faisait partie du quotidien des immigrants. À titre d’exemple, Enrique a immigré au Québec en 2009 en tant que travailleur qualifié. Au Pérou, il travaillait dans le secteur bancaire et il considère qu’il avait un bon emploi. Il a tout de même décidé d’immigrer en citant la sécurité comme raison principale :
Même si j’avais trouvé un bon travail, il y avait des questions sociales qui m’ont amené à prendre la décision de venir ici. La principale raison c’est la sécurité. Quand j’étais là-bas […], j’ai subi deux fois un vol. Pour plusieurs de mes amis, ma famille, il y a eu des cas où il y avait de la violence, des petits secuestros [kidnapping]. Maintenant, il y a beaucoup de façon de faire des choses comme ça. Je te prends, je t’amène à une ATM, un guichet, ça va être cinq minutes, mais avec un pistolet, ou quelque chose, tu marches dans la rue, on entre dans le guichet, tu sors l’argent et c’est tout. C’est la peur d’avoir des expériences mauvaises comme ça. Mes parents aussi, des voleurs étaient rentrés chez eux. C’est la sécurité. Même par exemple, dans la rue, le trafic, c’est terrible. Des voitures tout le temps. Ce sont des choses qui, moi, particulièrement, je n’aime pas ça. […] Je suis très sensible à ces choses-là. C’est important pour moi de traverser la rue en toute sécurité (Enrique, entrevue M724).
Ici, l’insécurité semble toucher plusieurs sphères de la vie quotidienne et prendre diverses formes selon les contextes : à la maison, à l’extérieur, ou en traversant la rue, on risque de se faire cambrioler, voler ou frapper par une voiture. Pour Christina, qui est arrivée au Québec en l’an 2000, l’insécurité était telle qu’elle ne voulait pas que ses futurs enfants et sa famille reste au Pérou. D’abord admise comme étudiante étrangère, elle a par la suite entrepris des démarches de résidence permanente pour être finalement acceptée au Québec quelques années plus tard en tant que travailleuse qualifiée. Elle a pris la décision d’immigrer en pensant à ses futurs enfants et à sa famille :
Je suis de la génération du terrorisme. Ça veut dire que je suis vraiment de la génération où il y avait des voitures piégées, des tours d’édifices tombées. […] C’est comme en Colombie maintenant, les gens pouvaient… Ils vivaient, on avait une vie normale, mais en même temps, il y avait tout le temps le risque de trouver quelque chose qui pouvait t’arriver. J’étais quand même dans un milieu assez protégé, à la capitale. J’avais étudié dans une école privée, mais je savais que dès que je finissais l’école, que je commençais à vivre la vraie vie, si j’allais dans une université publique, c’est là que ça a été un choc. J’ai compris que le monde était tout à l’envers et que c’était dangereux. Et c’est là qu’il y a eu justement les pires moments, quand je suis sortie de l’école privée, dans les années 1990. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Il y avait l’ambassade du Japon qui avait été prise en otage. C’était la pire année et il y avait beaucoup de violence dans la rue. Les gens se faisaient kidnapper, voler, etc. Il y a eu un épisode où je me suis fait voler et cela m’a beaucoup marqué. Alors, j’ai quand même appris à vivre, mais dans ma tête c’était clair que je ne voulais pas que mes enfants restent là et des années après, je ne voulais pas que ma famille reste là (Christina, entrevue F13).
La qualité de vie
Relativement à l’insécurité et à la violence, plusieurs participants ont révélé qu’ils avaient quitté le Pérou parce qu’ils étaient à la recherche d’une meilleure qualité de vie. Certains répondants avaient voyagé dans d’autres pays et ils avaient ainsi découvert qu’il était possible de vivre différemment et d’avoir accès à une meilleure qualité de vie à l’extérieur du Pérou. Parmi ces derniers, Alberto a quitté le Pérou en 2004 avec sa conjointe. En tant que comptable, il a été accepté au Canada comme travailleur qualifié. C’est à la suite d’un séjour en Allemagne, alors qu’il était en visite chez sa sœur, qu’il a réalisé qu’il voulait émigrer. Il explique ce changement de perspective ainsi :
Dans les années 1990, j’ai visité l’Europe. J’ai passé un mois et demi chez ma sœur en Allemagne. J’ai visité plein de villes. J’ai visité l’Europe et ça a changé à cent pour cent mon point de vue, et là, cela a tout changé mes idées, mes projets et tout ça. Et là, j’ai dit ça c’est le style de vie que j’aimerais avoir. La qualité de vie est beaucoup, beaucoup supérieure et j’ai réalisé qu’ailleurs la qualité de vie est beaucoup supérieure à ce que j’avais au Pérou. Tout est mieux (Alberto, entrevue M6).
Enrique a aussi eu une expérience de voyage similaire. À 23 ans, il est allé en Norvège et « à partir de là », il s’est dit « pourquoi ne pas habiter dans un autre pays qui va me donner une meilleure qualité de vie ? » (entrevue M7). En fait, dans la majorité des entrevues, le thème de la qualité de vie revient à différents moments au cours de l’entretien. Par exemple, lorsque j’ai demandé à Hugo ce qu’il aimait au Québec, il m’a tout de suite répondu que c’était la qualité de vie :
Qu’est-ce que j’aime ici ? Mais évidemment ce que j’aime beaucoup, c’est la qualité de vie. Tout Péruvien qui arrive ici, il reste juste une semaine, deux semaines, la première chose qu’il va dire c’est ça. Oui, la qualité de vie ça n’a rien avoir comparativement au Pérou (Hugo, entrevue M22).
Compte tenu du contexte socioéconomique péruvien, il n’est pas surprenant que les immigrants péruviens soient à la recherche d’une meilleure qualité de vie. En 2004, par exemple, 58,5 % de la population péruvienne vivait sous le seuil de pauvreté (Sánchez Aguilar, 2012 : 45). Quelques années plus tard, ce taux avait diminué pour atteindre 30,8 % en 2010 et 28,0 % en 2011. Malgré cette réduction de la pauvreté, le Pérou demeure toujours une société inégalitaire. Mis à part l’année 2009, le coefficient de Gini du Pérou s’est situé au-dessus de 0,5 durant toutes les années deux mille (Lavrard-Meyer, 2012). Notons que le coefficient de Gini est utilisé pour mesurer les inégalités de revenus dans une société. Une valeur nulle indique une égalité parfaite (où tous ont le même revenu) et à l’inverse, la valeur 1 révèle une inégalité complète (où la personne la plus riche dispose de la totalité du revenu disponible). À titre de comparaison, le Danemark, considéré comme un pays égalitaire, avait un coefficient de Gini de 0,251 en 2011 et le Canada, quant à lui, un coefficient de Gini de 0,314 cette même année (OCDE, 2015). Selon l’Observatoire des inégalités (2016), un coefficient de Gini de 0,4 et plus représente un seuil critique. Ajoutons aussi que pour la période 2003-2004, le décile des foyers les plus riches possédait 42 % du revenu total du Pérou, alors que 50 % des foyers les plus pauvres ont reçu 16 % du revenu total national (Sánchez Aguilar, 2007 : 117). Dans leur analyse portant sur la transformation des ménages au Pérou entre 1999 et 2009, Fuertes et Velazco (2013) soulignent également la vulnérabilité de la classe moyenne péruvienne en raison d’une multiplicité de facteurs, à la fois économiques et politiques. D’une part, « l’activité économique informelle de la classe moyenne entraine une volatilité accrue des revenus, dans un contexte d’absence de protection sociale » (Fuertes et Velazco, 2013 : 36). D’autre part, l’État a délaissé les politiques sociales universelles (visant les classes moyennes) pour miser uniquement sur la lutte contre la pauvreté (Fuertes et Velazco 2013 : 37). Ainsi, avec un taux de pauvreté élevé, la présence de fortes inégalités sociales et une classe moyenne vulnérable, il n’est pas étonnant que plusieurs Péruviens souhaitent émigrer.