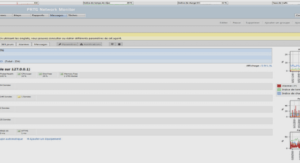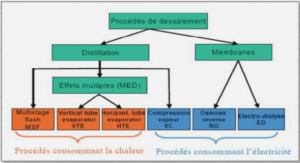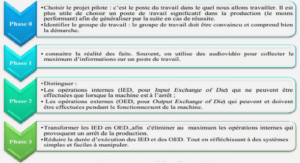PAR : Patrick BRUNET
L’aura populaire et littéraire du mot byzantin
Le mot « byzantin »
La consultation de l’édition de 1898 du Nouveau Larousse illustré127, est très éclairante sur l’évolution sémantique des termes « byzantin » et « byzantinisme », malmenés par des préventions historiques, littéraires et esthétiques, et c’est à travers le développement de l’article « Byzance », que les auteurs vont s’atteler à un véritable travail de restauration sémantique de ces mots.
Ainsi convient-il de ne pas s’en tenir à la valeur adjectivale de l‘article « byzantin », énoncée, de manière extrêmement concise, sous la forme suivante : « qui a rapport à cette ville ou à ses habitants : Décadence byzantine », l’article « Byzance » venant en effet déconstruire l’évidence de cette assertion. À plusieurs reprises, nous relevons des formulations qui apparaissent comme autant de corrections sémantiques :
Mais on étend à tort, à l’ensemble de l’empire grec d’Orient, le jugement que provoquent les épisodes de cette décadence lamentable, et il convient de revenir des préjugés anciens et défavorables qu’éveille le seul nom de byzantin128».
Il faut donc, en étudiant cette histoire, qui a été vraiment renouvelée dans ces derniers temps, écarter les préjugés vieillis qui s’attachent au mot « byzantin » ».
Le second extrait montre l’hommage rendu à une génération de byzantinistes, qui a su, en dépit de « la troisième chute de Constantinople 130», inaugurée au XVIIIᵉ siècle et encore tenace au XIXᵉ siècle, considérer scientifiquement l’empire byzantin, l’art byzantin tout particulièrement, en incitant le grand public a ainsi réorienter son regard. Les auteurs de l’article sont conscients de l’effort intellectuel qui doit être accompli pour appréhender plus justement le terme « byzantin ». Ajoutons que la présentation générale de l’article « Byzance » repose sur un raisonnement concessif, marquant la singularité de l’approche du monde byzantin, analogue à celui que nous retrouverons dans maints préambules à l’art byzantin dans les journaux de voyage : « Cet empire byzantin a été souvent jugé avec sévérité.
Sans doute il a eu des vices profonds […] et la subtilité de l’esprit grec y a multiplié les querelles religieuses […] mais c’est la civilisation, la plus brillante de tout le Moyen-Age 131». Si toutefois le terme « byzantinisme » est corrigé à la fin de l’article, il n’en reste pas moins vrai qu’il correspond à un moment historique de l’histoire de l’empire byzantin et qu’il est défini sévèrement de la sorte : On désigne ainsi les querelles subtiles et frivoles, par analogie avec les disputes religieuses où s’oubliait, en face de la menace des Turcs, le fanatisme étroit des Byzantins, du XIVᵉ et du XVᵉ siècles, préférant la ruine au rétablissement de l’union avec Rome ou ergotant sur la lumière incréée du Thabor 132».
Les « discussions subtiles et frivoles » constituent un véritable topos lexicologique qui semble figurer pour la première fois, avec quelques variantes, « oiseuses » ou intempestives 133», dans le Littré : « Byzantinisme – Néologisme : « État d’un peuple, d’une assemblée où les querelles sur des objets futiles occupent ou divisent les esprits, pendant que les dangers extérieurs sont menaçants134 ». Le TLF relève la première occurrence du terme, connoté négativement, dans le Journal de Michelet135 , alors que l’historien, comme nous le verrons, ne porte pas un regard hostile sur des édifices qu’il tient pour « byzantins ».
On pourrait ainsi établir une équivalence entre la critique de cet état d’esprit ratiocineur (l’article mentionnant judicieusement un aspect discuté de l’hésychasme, selon lequel une ascèse particulière permettrait au moine de percevoir cette « énergie divine136 » que représente la lumière thaborique) avec celle de l’esprit scolastique qui régnait dans les universités au Moyen-Age. C’est le sens de la critique de Pétrarque, Salutati et Bruni, qui, dès le XIV ᵉ siècle, fustigent cet aspect de l’enseignement médiéval, qui ramène la philosophie à une pure dialectique verbale 137, dont l’exemple le plus caricatural demeurent les discussions sur des questions quodlibétales138. Le « Byzantin » correspondrait bien à l’Homo loquax défini par Lucien Jerphagnon, ce « phraseur 139» qui s’entête et s’enivre dans l’exercice de la disputatio, cette culture purement dialectique et perçue comme assez vaine par les premiers Humanistes italiens 140.
Il est vrai que le terme « byzantin » s’était rapidement popularisé avec cette acception, comme on le constate aisément dans les journaux ou les revues non spécialistes de l’époque, qui ont donc contribué à le figer dans cet aspect caricatural. Nous pourrions relever quelques exemples significatifs de cet emploi courant du terme qui permettent de prendre la mesure de ce poids sémantique nouveau. Ainsi dans le compte rendu d’un livre dont il fait l’éloge, H. Carnoy souligne l’affectation des mœurs de son temps en ces termes :
Style et pensée coulent de source, comme un jaillissement continu d’ondes légères, limpides et chantantes. […] Tout vient du cœur et va au cœur. O. Chantal [auteur du roman Le Bel Orlando] a l’intuition psychologique, il a surtout le charme. Don rare et précieux entre tous, notamment par nos jours de brutalisme byzantin, de sophistication intellectuelle et morale ! 141».
Le néologisme « brutalisme 142» vient renforcer le caractère rigide, inanimé du terme « byzantin » et correspond parfaitement à l’un des topoi les plus développés dans le discours hostile à l’art byzantin que tiendront les voyageurs au XIXᵉ siècle, déconcertés par l’absence de vie de la manière byzantine. L’esprit raisonneur, vainement pointilleux, ratiocineur et rigide connaît une certaine fortune : « Il était ergoteur, avec un ton byzantin dans le discours 143», « Pour avoir disséqué ses personnages avec une complaisance de casuiste byzantin 144», « ces distinguos byzantins 145», « des discussions byzantines portant sur des pointes d’aiguilles administratives 146» ou encore dans un sens plus négatif, tendant vers la duperie, « ces pratiques byzantines sont en usage parmi les gros bonnets du turf 147».
Il est surprenant de constater qu’aujourd’hui, le Larousse en ligne, dans sa version simplifiée, mais très largement consultée, restreigne singulièrement les sens de « byzantin » et byzantinisme », réduisant à néant le travail intellectuel de restitution sémantique opéré à la fin du XIXᵉ siècle. Ainsi, dans la rubrique « Expressions », qui comporte trois entrées, l’emploi de « byzantin » est d’emblée connoté négativement : « Discussions, querelles byzantines : discussions oiseuses à force d’être subtiles ». Les deux autres entrées sont consacrées au « grec byzantin » et au « rite byzantin ». Quant au « byzantinisme », il est ramené à l’énoncé suivant : « Tendance aux discussions byzantines, à la subtilité hors de propos148 ». Le Grand Larousse de la langue française, dans l’édition de 1989, mentionnait pourtant comme première acception, l’« Etude de l’histoire et de la civilisation de Byzance », puis les « Aspects caractéristiques de certains objets luxueux et raffinés », et enfin, dans un « sens péjoratif », la « Tendance à la discussion oiseuse »et la « Tendance à la subtilité d’ordre moral 149». La disparition de la première acception, même dans la version simplifiée d’un dictionnaire, est lourde de sens et confirmerait l’hypothèse d’une involution lexicographique qui enferme le monde byzantin, ce que déplore, non sans une certaine ironie, M. Kaplan dans Pourquoi Byzance ?150.
Il conviendrait d’ajouter à ces réflexions sur le « byzantinisme », une dérivation lexicale, un néologisme à l’existence éphémère, le terme « byzantiner », façonné par les Goncourt, ainsi présenté dans le T.L.F. : « verbe intrans. Faire preuve de byzantinisme. N’esthétisons pas, ne byzantinons pas (E. et J. De Goncourt, Journal, 1870, p. 595) ». Faut-il voir dans l’équivalence de ces deux assertions, une boutade que les « Byzantins de Paris 151» s’adresseraient à eux-mêmes ? L’analogie avec le travail du mosaïste a en effet souvent été utilisée pour qualifier l’écriture artiste des Goncourt, comme le relève M.-F. David-De Palacio152, et ce mimétisme de l’écriture, « admirable mosaïque où les mots étincelants dessinaient de capricieuses arabesques 153», joint à une prédilection pour les effets de transparence de la matière et de cristallisation dans la peinture154, pourraient témoigner d’une certaine emprise byzantine sur les Goncourt. En outre, même s’ils entretiennent un rapport ambigu avec des œuvres qu’ils qualifient de « byzantines », il n’en reste pas moins vrai qu’ils s’inscrivent dans le sillage de Gautier,155, attaché à réhabiliter, à reconsidérer l’architecture et les mosaïques byzantines.
Nous mesurerons mieux l’évolution sémantique du terme « byzantin » au XIXᵉ siècle, en nous référant à un dictionnaire de la première moitié du siècle, le Complément du Dictionnaire de l’Académie Française, de 1847156(le mot ne figurant pas dans l’édition de 1835 du Dictionnaire de l’Académie Française). La définition semble encore empreinte du souvenir de l’engouement du Grand Siècle pour l’histoire de l’art byzantin : « Les historiens byzantins ou les Byzantins (subst.) : se dit particulièrement des historiens qui sont venus après Procope, et qui traitent l’histoire de l’empire de Byzance ou des pays limitrophes » / Grec byzantin / Byzantine : collection des historiens byzantins ». En mentionnant la Byzantine du Louvre, l’article rendait hommage à l’inlassable travail d’érudition entrepris notamment par Du Cange, qui utilise le terme « byzantina », dans Historia byzantina157, lequel doit être entendu, selon Jean-Michel Spieser, comme une consécration savante158. C’est cette byzantinologie » érudite du XVIIᵉ que mettront à mal trois grandes figures, Gibbon, Montesquieu et Voltaire159, figeant dès lors le terme« byzantin » dans une aura de décadence, laquelle l’esprit fin de siècle donnera une ampleur toute particulière, mais que la vogue des « romans byzantins » transformera, en réhabilitant l’image de Byzance.
La vogue des « romans byzantins »
O. Delouis estime en effet qu’il convient de distinguer un « orientalisme décadent (de déviation) […] d’un orientalisme scientifique (de reconstitution) 160», afin de rééquilibrer le regard porté sur la littérature byzantine en général, trop axé sur le byzantinisme fin de siècle, au détriment des « romans byzantins 161», qui essaiment en France, à partir de 1890.
Le premier type d’orientalisme, dont émanent des « romans d’invocation » de Byzance162, se délecte d’une morbidité qui semble consubstantielle au déclin de Byzance, qui est conforme à une image abîmée, souillée, viciée de Byzance, laquelle est d’autant plus forte qu’elle fait écho à un sentiment de décadence occidentale perçue au XIXᵉ siècle. Nous étudierons comment cette « conscience de la décadence », ce goût pour la « pourriture noble » que constituent les périodes de déclin innervent souvent le jugement esthétique sur l’art byzantin des voyageurs, et Barbey d’Aurévilly résume avec le plus de vigueur l’écho byzantin rendu par À Rebours de Huysmans : « Le livre de M. Huysmans n’est pas l’histoire de la décadence d’une société, mais de la décadence de l’humanité intégrale. Il est, dans son roman, plus Byzantin que Byzance même 163».
À l’opposé, les « romans byzantins », « romans d’exposition » de Byzance concourent à la réhabilitation de l’image de Byzance, inaugurée selon O. Delouis en 1870, avec la publication de Constantin Porphyrogénète d’Alfred Rambaud, de manière analogue à l’esprit qui animait les auteurs de l’article « Byzance », dans le Nouveau Larousse illustré, de 1898. Il n’est d’ailleurs pas anodin qu’ils évoquassent l’autorité de Rambaud, corrigeant les perspectives aberrantes portées sur le monde byzantin : « Byzance a été pour le monde slave et oriental, ce qu’a été Rome pour le monde occidental et germanique 164». Cette vogue des romans byzantins165 s’inscrit dans un engouement plus général encore pour Byzance, provoqué par le succès de Théodora de V. Sardou en 1884, et nul doute que cet orientalisme scientifique, érudit166, a pu recomposer l’imaginaire byzantin du grand public en s’appuyant précisément sur un imaginaire sonore, des plus séduisants. Ainsi, après avoir constaté que « la mode [était] au byzantinisme, qui fut longtemps si décrié ou plutôt si peu connu », Francis de Crue, dans un article de 1894167, énumère des noms de fonctions administratives, politiques et militaires à la cour de Byzance, dont les signifiants seuls constituent un monde sonore oriental fascinant :
La magnificence de l’empereur produisit déjà un grand effet avec son entourage somptueux de logothètes, de stratopédarques, de drongaires, patrices protospathaires et protonotaires 168».
Une certaine ambivalence pourrait toutefois être relevée car si ces mots s’avèrent des signifiants remarquables pour l’œil qui sait écouter, ils peuvent aussi, par leurs effets d’allitérations et leurs sonorités assez dures, contribuer à présenter une image très figée de la cour byzantine, mécanique, et c’est là un argument hostile à l’art byzantin qui connaîtra une certaine fortune dans les récits de voyage.
Mais, d’une manière plus générale, si l’on accepte l’hypothèse d’un « style byzantin » inhérent à ces romans, ce que montre M.-F. David-de-Palacio169, on pourrait également le caractériser par son asianisme, et il est étonnant de constater à quel point l’analyse que fait Mirbeau du roman de Jean Lombard, L’Agonie, ressemble, tant sur le plan stylistique que par l’ambivalence de la critique, aux jugements esthétiques sur l’art des voyageurs de notre corpus :
Il est possible que [le critique] soit encore choqué par ce style barbare, désordonné, furieusement polychrome, un style forgé de mots techniques, pris aux glossaires de l’Antiquité. Mais il reconnaîtra que, malgré ses défauts de goût et son manque de mesure, ce style a pourtant grande allure, des sonorités superbes, un fracas d’armures heurtées, un vertige de chars emportés et comme l’odeur même – une odeur forte de sang et de fauves- des âges que Lombard évoque 170».
On pourrait, à partir de cet extrait, établir des équivalences avec le schéma général du discours esthétique tenu par les voyageurs au XIXᵉ siècle. Ainsi, le « style barbare, désordonné » rappellerait les maladresses artistiques, la perspective inversée de l’art byzantin, tout ce qui constitue le topos d’un art retombé en enfance, négligent en un mot. Les « mots techniques, pris aux glossaires » pourraient se rapporter à l’inféodation des artistes byzantins aux schèmes religieux, à des formes immuables – à cette réserve près, bien entendu, que la source serait plutôt le fameux Guide de la peinture du moine Denys. La notation « furieusement polychrome », par la vigueur de son antéposition, viendrait souligner l’intensité du charme visuel de l’art byzantin, autre grand topos des relations de voyage ; il s’agirait en outre d’un art susceptible d’ouvrir des interprétations synesthésiques, chez les voyageurs comme chez les byzantinistes du XIXᵉ siècle – et l’on pourrait trouver un prolongement de ce trait chez des byzantinistes modernes, si l’on songe aux « tons très sonores 171» des mosaïques de Saint-Apollinaire-in-Classe relevés par Grabar. Les dernières lignes évoquent des hypotyposes analogues à celles que le spectacle des mosaïques peut induire, transportant le spectateur dans une dimension anagogique. Ainsi le cheminement de la critique littéraire du livre de Lombard, peut-il se superposer au jugement esthétique général sur l’art byzantin, tel que nous l’avons observé dans maints journaux de voyage.
La seconde caractéristique du style « byzantin » des romans d’invocation, comme ceux d’exposition de Byzance, est qu’il est innervé d’oxymores, d’antithèses qui flattent un imaginaire morbide, par leur caractère hyperbolique, leur véhémence, ou qui restituent un climat politique, une réalité des mœurs violents, sous la forme d’hypotyposes. Il faut bien comprendre que la littérature fin de siècle a créé un horizon d’attente, en termes de morbidité, auquel répondront nombre de romans byzantins. O. Delouis a étudié les principaux motifs de ces romans, spécifiquement urbains, exhibant un fascinant mélange de vices, de « déviations religieuses », de luxe et de contrition172. Or, c’est plus particulièrement sur la personne de Théodora que se cristalliseront ces fantasmes de sexualité dépravée, de souillure et d’ascèse, au point d’en faire, comme nous le verrons, un personnage romanesque fascinant.
Une puissance oxymorique séduisante
C’est ainsi que l’adjectif « byzantin » se chargera progressivement, au XIXᵉ siècle, d’une remarquable puissance oxymorique, et qu’il se trouvera pris dans les rets de la morbidité. Hugues Le Roux, dans Les Amants byzantins, résume ainsi cet imaginaire byzantin : Byzance, c’est du christianisme et du paganisme, du mysticisme et de la luxure […] toutes les extrémités, tous les contrastes en un tas, -les nacres de la perle et de la pourriture173 ».
Cette pression oxymorique peut trouver son origine dans la « constitution » même de l’empire byzantin, Constantin choisissant en effet comme capitale une ancienne cité grecque, puis romaine, soumise enfin aux assauts barbares, toutes ces strates culturelles, administratives, guerrières, venant s’ajouter au rôle stratégique qu’elle endossa, contrôlant le commerce de la Mer Noire et devenant, dans l’imaginaire populaire du XIXᵉ siècle, ce lieu formidable de passages, d’influences réciproques entre l’Orient et l’Occident. Maupassant utilisera d’ailleurs la métaphore de la fermentation pour souligner l’énergie propre aux mouvements qui traversent Byzance : […] elle semble dans le mystère qui l’entoure, une ville étrange, où tous les instincts humains, toutes les grandeurs et toutes les ignominies, toutes les vertus et tous les vices fermentaient à la frontière de deux continents, à l’entrecroisement de deux civilisations 174».
Nous retrouverons cette métaphore appliquée à l’art byzantin, destinée à dénoncer l’influence funeste de ses pratiques artistiques sur le sol italien.
Cette explication historique de la poétique de l’oxymore dans l’évocation du monde byzantin concerne également Ravenne, souvent perçue dans un rapport de tension entre une romanité ancienne, revendiquée, et l’esprit ostrogoth, supposé la détruire, ou au contraire la régénérer.
Le seul nom de « Byzance » emporte en lui un imaginaire oriental au sein duquel s’épanouissent les caractères de l’asianisme, et Jules Claretie, en invoquant ce nom, en montre la puissance performative, analogue à celle de certains aspects de l’art byzantin établis par Otto Demus175 : Byzance ! Et à ce nom, tout aussitôt des visions de figures étranges, d’une séduction inquiétante, m’apparaissent comme se détachant sur le fond d’or des mosaïques […] autre Rome transplantée hors de Rome, mais maladive et plus sanglante encore dans ses jeux, dans ses pompes, dans son luxe et sa luxure 176».
Ainsi, à peine prononcé, le mot s’ouvre et délivre une présence confuse, plutôt morbide, mais l’analogie avec l’expérience esthétique de l’animation des figures byzantines est ici explicite, et c’est celle que nous retrouverons, en termes pacifiés, sous la plume de Gautier, à la basilique Saint-Marc 177, ou dans les études sur l’art byzantin du XIXᵉ siècle 178.
Mais un point essentiel doit être mentionné, qui montre une fois encore, la singularité de Byzance comme sujet romanesque et objet d’étude, c’est l’érudition dont font preuve les auteurs de romans byzantins. Il n’est pas rare en effet que des traductions originales de chroniques byzantines médiévales figurent dans ces romans 179, ce qui en fait non seulement des romans précieux d’exposition du Bas-Empire byzantin – les distinguant d’une littérature décadente qui n’accaparait Byzance que pour l’inféoder à des thèmes morbides – mais ce qui contribue également à inspirer le travail des historiens byzantinistes. Ainsi, fait assez rare dans l’historiographie d’une période historique précise, ce sont les romanciers et les dramaturges qui devancent les historiens, Diehl écrivant une monographie sur Théodora en 1904, destinée à un large public, après que le personnage avait émergé des romans byzantins et s’était popularisé depuis 1884, date de la création de la pièce de V. Sardou180. Il est donc clair que la vogue des romans byzantins, puis le succès populaire rencontré par des byzantinistes, tels Alfred Rambaud, Charles Diehl, Gustave Schlumberger, ou Louis Bréhier s’inscrivaient dans une mission de réhabilitation de l’image de Byzance et Léon Bloy, fustigeant l’imaginaire « de pacotille » façonné par les romans historiques à la manière de Walter Scott, rendit ainsi hommage au travail de G. Schlumberger 181 : « On lit cela [Le Comte Robert de Paris 182] à 16 ou 18 ans et on reste sur l’impression d’une cour byzantine machinée comme une scène de boulevard, avec des courtisans ou des fonctionnaires automates, prosternés devant un empereur gâteux dont la puissance est un décor que les chevaliers d’Occident peuvent enfoncer d’un seul coup de leur poing ganté de fer […] C’est l’ambition des byzantinistes contemporains de restituer, autant qu’il se peut, la Cité merveilleuse et le merveilleux empire 183 ».
C’est donc bien l’éloge d’une érudition vivante, permettant de préserver le lecteur d’un imaginaire étriqué et caricatural, auquel se livre L. Bloy et la réhabilitation de l’image de Byzance s’appuyant elle aussi sur une érudition avérée, sera menée par V. Sardou, assurant la consécration du personnage de Théodora dans l’imaginaire de son époque.
Comme nous l’avons mentionné, Diehl s’est « pris au jeu » de la littérature, s’inscrivant dans cette vogue du néo-byzantinisme, tout en se démarquant d’une littérature « décadente », pour laquelle Byzance constituait un thème de délectation morbide . Rédigeant une « défense et illustration de la grande basilissa byzantine 184 Théodora, en 1902,il se livre ainsi à une description précise des traits de l’impératrice, en les confrontant à l’image que les mosaïques de Saint-Vital proposent : « Elle était jolie en effet, assez petite de taille, mais d’une grâce extrême ; et son charmant visage, au teint mat un peu pâle, s’éclairait de grands yeux pleins d’expression, de vivacité et de flamme. De ce charme tout-puissant, il reste bien peu de chose dans le portrait officiel qu’on voit à Saint-Vital de Ravenne. Sous le lourd manteau impérial, la stature paraît plus rigide et plus haute ; […] sous le diadème qui cache le front, le visage menu, délicat, avec son ovale un peu amaigri ; son grand nez droit et mince, a une gravité solennelle, presque mélancolique. Un trait seul subsiste dans cette figure flétrie : ce sont sous la barre sombre des sourcils qui se joignent, les beaux yeux noirs dont parle Procope, qui illuminent encore et semblent manger le visage. Si l’on veut donc aujourd’hui se faire quelque idée de ce qu’était en son éclat cette beauté célèbre, c’est ailleurs plutôt qu’il faudrait regarde, vers ces portraits où tels peintres modernes, un Clairin, un Benjamin Constant surtout, ont tenté de faire revivre l’image évanouie de Théodora et, s’inspirant heureusement de la mosaïque de Ravenne, ont rendu à la froide et immobile figure quelque chose du charme disparu. 185».
Diehl nous surprend dans sa manière de décrire certaines œuvres byzantines, a fortiori lorsqu’il s’agit d’un panneau de mosaïques aussi renommé que celui de Saint-Vital. Le portrait physiognomonique qu’il dresse de Théodora, révélant son aura de séduction, contraste en effet avec l’image éteinte, anémiée qu’elle présente, figée dans les mosaïques ravennates. Le pouvoir de son regard est atténué : c’est une relique fragile, comme le note l’adverbe, et il semble difficile de ne pas lire l’expression d’un certain dépit dans l’énoncé « semblent manger le visage ». A cette disproportion dans la composition du visage s’ajoutent la disparition du corps que le manteau et le diadème tendent à réifier, et la métaphore de la « barre sombre » accentue cette impression 186. Enfin, l’énoncé « presque mélancolique » affecte et entrave la gravité du visage qui sied à l’impératrice, soulignant l’absence du personnage vis-à-vis d’elle-même et dans l’échange iconique avec le spectateur. Ce dernier aspect pourrait rappeler le constat d’un voyageur : « « Les yeux sont extraordinaires. On ne les rencontre pas. Ils regardent un peu à droite et non dans le vague. Ils regardent quelque chose qui vient et n’apporte point la joie 187 ». Burckhardt remarque en outre l’ « air morose » de la Vierge et des figures byzantines 188, pétrifiées dans des schèmes mortifères. Cette mélancolie semble d’ailleurs, pour certains voyageurs comme Jules Logerotte, constitutive du premier art byzantin, dans son lieu ravennate, puisqu’il relie dans son journal « les grands yeux mélancoliques de cette longue figure austère » que représente le Pantocrator de Monreale à la manière des « premiers peintres byzantins 189». L’aveu d’une déception esthétique à l’égard du panneau de Saint-Vital est manifeste lorsque Diehl incite le lecteur, dans ce passage, mais aussi dans la préface de l’ouvrage 190, à aller chercher une plus exacte correspondance entre la personne de Théodora et sa représentation dans des œuvres contemporaines. Les peintres qu’il mentionne s’inscrivent donc dans un rapport mimétique de parachèvement et de perfectionnement d’une œuvre puisqu’ils parviennent à restituer de manière plus vivante « les mouvements d’âme » que son regard trahissait 191; la nostalgie d’un illusionnisme mimétique agit comme un retour du refoulé qui ne permet plus de regarder le panneau de Ravenne dans sa dimension liturgique, anagogique, ni d’être sensible à cette autre « présence » que propose l’art byzantin. Etrange détour auquel nous convie le byzantiniste !
Benjamin-Constant192 représente Théodora assise sur un trône inspiré de chaires épiscopales ou d’un trône abbatial 193, en marbre de Carrare, veiné d’orange et de jaune, dont la partie supérieure du dossier, en demi-cercle, vient nimber l’impératrice, rappelant l’image de la Vierge, bien éclairée, figurant sur le bas de sa robe. On peut concevoir cette présence iconographique comme un écho ravennate, une scène brodée de l’Adoration des Rois mages apparaissant dans les plis de la stola de Théodora. Le peintre a pu également s’inspirer du trône dit de Charlemagne à Aix-la-Chapelle, d’autant plus qu’à l’époque où il réalise sa toile, il était établi que Saint-Vital avait servi de modèle structurel pour la chapelle palatine et le réemploi de certains de ses marbres à l’intérieur de la chapelle était bien documenté194. Le nimbe marmoréen, bien détaché sur un fond de marbre noir, est éclairé de manière très contrastée, comme le visage de l’impératrice, soulignant ainsi sa dualité légendaire, fantasmée. Les accotoirs surélevés obligent le corps à se déployer : le buste est droit, les épaules écartées, les mains ballantes mais pas nonchalantes, et surtout, et c’est bien là est le point essentiel, Benjamin-Constant évite de lui imposer une raideur hiératique. Le corps semble ainsi parfaitement s’adapter au trône, consacrant son rang d’impératrice. Indéniablement, le marbre est un protagoniste du tableau et la subtile carnation de Théodora, aux reflets fauves, s’allie parfaitement à la clarté du marbre : ce tableau nous présente donc Théodora comme un formidable marbre vivant. On pourrait, métaphoriquement, dire que le trône « saisit » Théodora, comme le trône de Charlemagne « saisit le nouveau roi de Germanie » à partir du Xᵉ siècle 195: il la consacre dans une autorité qui ne dissipe pas les traits saillants de sa personnalité. Diehl devait en outre être sensible à ce visage vivant, dont la discrète sensualité des lèvres et la belle autorité du regard rappelaient plus précisément que ne pouvait le faire le panneau de Ravenne, l’aura de l’impératrice. Le dessin de Clairin est moins original : il représente l’impératrice dans un camaïeu de brun, dans une attitude plus hiératique, tenant un grand sceptre d’une main tandis qu’elle enserre de son autre main une croix sculptée sur le montant antérieur d’un cadre décoratif ressemblant aux niches de sculptures. Seul le visage, dépourvu de toute autorité, disparaissant sous une coiffe imposante, rend sensible sa complexion humorale.
Nous avons intentionnellement interprété en termes psychologiques ces deux tableaux car c’est cette approche que privilégie Diehl lorsqu’il exprime ses réserves à l’égard de certaines créations byzantines, regrettant que la manifestation de la vie ne pût s’y révéler dans toute sa complexité. Mais on peut également y voir, dans une perspective historique, l’affirmation d’une préférence pour une phase ultérieure de l’art byzantin, celle de la renaissance du IXᵉ siècle. Ainsi Diehl formule-t-il, de manière élogieuse, cette évolution dans la composition et les types iconographiques, assurément plus expressifs : « Il semble que les artistes byzantins aient abandonné en partie l’imitation des modèles antiques pour regarder autour d’eux et faire, dans un esprit tout réaliste, de véritables portraits inspirés du monde cosmopolite et bigarré où ils vivaient ». Il remarque en outre le « sens naturaliste tout à fait remarquable 196» de ces innovations, abandonnant Ravenne et sa séduisante rigidité dans les limbes de l’art byzantin.
Coptomanie et byzantinomanie
Une comparaison avec l’engouement pour le monde et l’art coptes, une décennie plus tard, permettrait de mieux comprendre encore le caractère érudit, et très singulier, de ce climat byzantin qui aboutit, dans les années 1880, à une véritable byzantinomanie.
On peut considérer que les découvertes archéologiques du site d’Antinoé, menées par Albert Gayet, entre 1896 et 1910, vont permettre la « révélation 197» de l’art copte, les plus belles pièces de tissus étant exposées dès 1900 pendant l’Exposition universelle de Paris, assurant ainsi rapidement leur renommée. Le mot « copte », comme son acolyte « byzantin », fait son apparition dans les journaux et revues populaires. Nous étudierons plus loin les affinités ressenties par les voyageurs entre le style pictural des tissus coptes et la stylisation des mosaïques byzantines, ainsi que le malentendu esthétique qui les a frappés tous les deux. C’est davantage la mise en lumière du mot « copte » qui nous intéresse, ainsi que la réception littéraire de l’art copte.
Table des matières
INTRODUCTION
La littérature de voyage
Le journal de voyage et la folle intertextualité
L’aria byzantine
Le corpus : justification et perspectives
Les textes
Intentions
PREMIÈRE PARTIE : L’aria byzantine
1.1 L’aura populaire et littéraire du mot byzantin
1.1.1 Le mot « byzantin »
1.1.2 La vogue des « romans byzantins »
1.1.3 Une puissance oxymorique séduisante
1.1.4 Coptomanie et byzantinomanie
1.1.5 Théodora, reflet de Byzance et de Ravenne
1.2 Le mot « byzantin » dans le champ de l’histoire de l’art
1.2.1 Les origines
1.2.2 Une approximation et une ambiguïté sémantique
1.2.3 Préparer son regard, périodisation de l’art byzantin par Bayet, Millet, Diehl
1.2.4 L’art byzantin dans ses rapports à l’architecture
1.2.5 La vogue du néo-byzantinisme
1.2.6 L’esprit de l’art byzantin selon Gautier et la renommée du Manuel de Denys de Fourna
1.2.7 L’imaginaire byzantin pictural
1.3 L’art byzantin dans les guides de voyage
1.3.1 L’expérience du guide de voyage
1.3.2 Etude de la présence de l’art byzantin dans les guides de voyage
DEUXIEME PARTIE : L’hostilité à l’art byzantin : une figure imposée, non exempte d’ambiguïté
2.1 Une absence constatée
2.1.1 Un art « barbare » : entre négligence et grandeur paradoxale
2.1.2 « Un air farouche et grognon » (Burckhardt)
2.1.3 Raideur, rigidité
2.1.4 L’asservissement aux dogmes
2.1.5 Un art distant, absent, étranger
2.2 Le regard « byzantin »
2.2.1 Un regard absent
2.2.2 Un regard qui menace et ébranle l’architecture
2.3 La tragédie de l’art byzantin
2.3.1 Une force artistique mortifère : Reinach et les Goncourt Un regard tératologique : Taine
2.3.2 La névrose byzantine
2.4 L’enfermement
2.4.1 Dans les rets de la comparaison : une dénomination difficile et une imposture
2.4.2 Le démon de l’analogie
2.4.3 Une négligence coupable
2.4.4 Un art sclérosé en attente d’une rédemption artistique
2.5 Vacillements
2.5.1 De l’aveuglement au sentiment de l’art byzantin : Taine
2.5.2 Suarès, lecteur de Taine
TROISIEME PARTIE : Les lieux byzantins comme espaces de débats stylistiques
3.1 Ravenne
3.1.1 Théodoric : le Sauveur épris de romanité
3.1.2 Le préambule de Ravenne
3.1.3 Le fantôme de Ravenne
3.1.4 Les édifices
3.1.5 Ravenne, relique byzantine, paléochrétienne ou ravennate ?
3.2 Venise
3.2.1 Une redoutable description
3.2.2 « Une macédoine de styles »
3.2.3 Art, inspiration, style, esprit, caractère, sentiment byzantins à Venise
3.3 Torcello, Murano
3.3.1 L’esseulement de Torcello
3.3.2 Torcello mise en scène
3.4 Palerme – Cefalù – Monreale
3.4.1 L’aventure sicilienne
3.4.2 Le caractère « byzantin » en Sicile
QUATRIEME PARTIE : L’expérience vivante de l’art byzantin
4.1 La révélation de l’écriture
4.1.1 Les valeurs de l’oxymore
4.1.2 L’omniprésence oxymorique
4.1.3 La lumière reconnue
4.1.4 L’oxymore et l’antithèse, figures stylistiques d’une rédemption
4.1.5 Des synesthésies libératrices
4.1.6 Un écart stylistique
4.2 La vie des matériaux
4.2.1 Ressentir les « effets de matière »
4.2.2 Le marbre. Des colonnes aux placages : une présence vivante dans sa varietas
4.2.3 La mosaïque, « fidèle compagne de l’architecture » (Fulchiron) : une méthode pour l’appréhender
4.2.4 La matérialité des mosaïques et l’aura de la grotte
4.2.5 La mosaïque perçue et conçue comme un style
4.2.6 Mosaïque et vitraux : une analogie vivante
4.3 L’harmonie dynamique de l’espace sacré
4.3.1 La lumière vivante
4.3.2 La vie des fonds d’or : l’énergie de la lumière
4.3.3 « Fourmillement » : une présence radieuse
4.3.4 Architecture : entre naturalisation et simplicité, l’expression d’une vive harmonie
4.3.5 Une architecture musicale
4.4 L’ornement byzantin et la vie des formes : Un « espace communicatif » (Duthuit)
4.4.1 Décor et ornement : un statut ambigu
4.4.2 Regarder l’ornement, ressentir l’ornemental
4.4.3 Le sens expressif de l’ornement byzantin
4.4.4 L’expérience métaphysique de l’ornement
4.4.5 Bayet et Diehl aux prises avec l’ornement
4.4.6 La rêverie d’Albert Gayet
4.5 L’opération de l’ekphrasis
4.5.1 L’ekphrasis ou les promesses d’une « vivacité visuelle »
4.5.2 Revisiter l’ekphrasis byzantine
4.5.3 Un monument gautiériste : le description de Saint-Marc
4.5.4 Le naturalisme
4.5.5 La fête syncrétique
4.6 La présence de l’art byzantin
4.6.1 Un art vivant
4.6.2 La réhabilitation de l’expression comme affirmation d’un art vivant
4.6.3 Le pouvoir des mots
4.6.4 « Un mouvement secret, irrésistible » G. Duthuit
4.6.5 Un voyage vivant
4.7 Une psychologie de la réception
4.7.1 L’apaisement
4.7.2 Le sentiment du sublime
4.7.3 L’harmonie
4.7.4 L’Ailleurs resplendissant
CONCLUSION
Télécharger le rapport complet