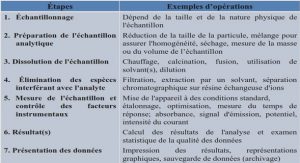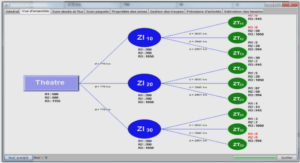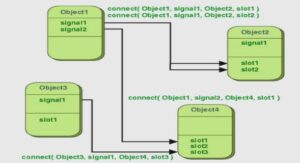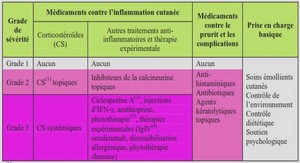Montage interdit et métaphore interdite ?
L’image permet donc, selon la façon dont elle est comprise, tout autant de dévaluer la métaphore que de la réévaluer. Mais ce n’est pas seulement cette autre compréhension de l’image, plus riche, susceptible de s’appliquer à la métaphore, qui impose de découpler les deux soupçons. Il existe aussi des conceptions positives de l’image qui excluent la métaphore de leur champ, qui réhabilitent l’une sans réhabiliter l’autre. Je pense en particulier aux écrits d’André Bazin et à la tradition qu’il a contribué à rouvrir, toujours vivante aujourd’hui, qui apparaît par exemple sous la plume de certains cinéastes russes d’aujourd’hui, ou chez Michael Haneke, sans parler des nombreuses études critiques ou universitaires qui en partagent les termes. Dans cette conception, la richesse de l’image, liée à sa nature indicielle, s’opposerait notamment à la pratique du montage qui, entre autres interventions sur l’image, la mutilerait. Cette thèse s’illustre particulièrement dans l’article « L’évolution du langage cinématographique » tel qu’il est publié en 1958 dans Qu’est-ce que le cinéma ? mais on en trouve des prolongements, avec de nettes inflexions évidemment, chez Christian Metz par exemple, dans « Le cinéma : langue ou langage ? », publié en 1964 dans la revue Communications, et jusque chez Gilles Deleuze, dans L’Image-mouvement et L’Image-temps en 1983 et 1985. Il ne s’agit pas pour moi de rentrer dans une discussion déjà ancienne, de réfuter une nouvelle fois cette opposition entre un cinéma du « montage-roi » et un autre qui serait davantage soucieux du réel, mais seulement de montrer comment cette distinction se nourrit du soupçon sur la métaphore et le nourrit en retour. Il est d’ailleurs intéressant de noter que cette idée émerge en même temps que celle, rencontrée chez Albert Henry, s’appuyant sur Esnault et Estève, d’une métonymie plus respectueuse des liens inscrits dans les faits et d’une métaphore faisant toujours violence au réel. C’est également à la même époque, en 1961 et 1964, que Roland Barthes expose l’idée d’un « message sans code » qui serait celui de la photographie et que, dans « Rhétorique de l’image », la métaphore est placée parmi ces « signifiants de connotation » qui se superposent, d’une certaine façon, à la dénotation, ce « bain lustral d’innocence » que vient corrompre « le monde discontinu des symboles ». Malgré la prudence du sémiologue, malgré l’usage du conditionnel et de divers autres modalisateurs, cette « sorte d’état d’adamique de l’image » n’apparaît pas seulement comme un mythe efficace pour expliquer le pouvoir de l’image : à la suite de Bazin, Roland Barthes évoque ce « fait anthropologique “mat”, à la fois absolument nouveau et définitivement indépassable » que constitue « l’avoir-été-là » de l’image photographique et choisit bel et bien de lire dans l’image un niveau dénotatif « pur », distinct et comme débarrassé de sa double gangue textuelle et connotative, la première ayant notamment « une valeur répressive » face « à la liberté des signifiés de l’image », à sa polysémie, et la seconde témoignant d’une rhétorique de l’image où intervient (encore) l’idéologie.387 La métaphore fait donc partie de cette rhétorique finalement commune « au rêve, à la littérature et à l’image », lieu par excellence des traits « erratiques » de signification dont le niveau dénotatif semble purifié, même s’il les accueille, s’il les « naturalise » en leur offrant son « bain lustral d’innocence ». La figure d’analogie n’a plus rien de « concret », de « matériel » : elle abandonne à l’image authentique ce pouvoir ; appartenant au niveau connotatif, rhétorique, elle baigne dans l’idéologie, avec toute l’ambiguïté du terme, surtout quand est reconnue par ailleurs la possibilité d’un message sans code. Il faut dire qu’en plus, avec la publicité de Panzani, nous avons un cas de métaphore in absentia où c’est le comparant – par exemple la corne d’abondance – qui manque. Voilà qui renforce d’autant plus l’idée d’illusion, sans parler du sentiment d’idéologie, surtout quand l’image est déjà identifiée comme possédant cette fonction de propagande, puisque la métaphore est perçue comme à la fois présente et absente, comme s’imposant de l’extérieur. Le schéma n’est pas fondamentalement différent chez André Bazin, même si la réflexion de celui-ci ne s’encombre pas de références linguistiques ou sémiologiques et s’il s’appuie principalement sur le cinéma. On sait qu’il est possible, comme le fait Charles Tesson par exemple, de lire chez lui une même croyance dans un Éden de l’image.388 Je ne crois pas nécessaire non plus de rappeler comment, dans « Ontologie de l’image photographique », il propose une magistrale réflexion sur la « querelle du réalisme » et, dans « Montage interdit », de beaux développements sur le « truquage » du montage. En revanche, il faut souligner que ce qui gêne Bazin dans ce dernier article, en particulier dans le film de Jean Tourane, ce n’est pas tant le montage en lui-même, ses possibilités de « truquer » la perception de la réalité, comme cela se produit dans Crin-Blanc de toutes façons, c’est plutôt que le trucage ne s’avoue pas, qu’il n’attire pas l’attention sur lui comme le ferait, par exemple, le dressage d’animaux, comme c’est le cas dans Rintintin, autrement dit qu’il recourt à une facilité et ne produit pas ainsi la même qualité d’émotion.389 De même, à l’inverse, ce qui intéresse Bazin dans son premier article, ce n’est pas tant la « véracité » de l’image photographique, sa prétendue objectivité, que le rapport de croyance que l’on entretient avec elle – d’où la possibilité mentionnée d’un usage « tératologique », surréaliste, celui d’une « hallucination vraie », lorsque la photo réussit, bien mieux que les peintures en trompe-l’œil des amis de Breton, à produire un effet d’illusion sur nous.390 Aussi S. M. Eisenstein est-il opposé, dans « Ontologie de l’image photographique », au réalisme de Repine : il n’est pas encore concerné par la critique de Bazin, il apparaît même comme le Tintoret du cinéma. Et, de fait, l’auteur partage avec le cinéaste la même aversion pour la perspective, ce « péché originel de la peinture occidentale ».391 Un réalisme « baroque » semble possible en 1945 à l’auteur de l’article : il s’agit de distinguer « le pseudoréalisme du trompe-l’œil (ou du trompe-l’esprit) qui se satisfait de l’illusion des formes », cette dimension « psychologique » que l’on retrouve dans le réalisme socialiste, et « le véritable réalisme », le réalisme essentiel, le seul à posséder une véritable dimension esthétique, déjà présent dans l’art médiéval et compatible avec une approche spirituelle. Or, ici, Eisenstein et le Tintoret ne sont pas le moins du monde du côté de « l’illusion des formes » : c’est Aragon qui est visé, qui parle de la peinture « comme on aurait pu le faire au XVIIIe siècle » et qui évoque Eisenstein comme si c’était Repine, ne sachant pas voir que la Russie, si elle fait « de la mauvaise peinture », « fait du bon cinéma ». Voilà qui témoigne, sur la question du réalisme, d’une indéniable subtilité. Ce qui est plus gênant, en revanche, c’est la façon dont les choses se présentent dans « L’évolution du langage cinématographique », qui rassemble des analyses rédigées entre 1950 et 1955 : il s’agit toujours de défendre la puissance d’événement du photogramme, le « réalisme essentiel » des meilleures réalisations, mais cela se fait désormais sur fond de malentendu – précisément celui auquel Bazin a pris soin d’échapper, pour l’essentiel, dans les articles précédents, quand il ne l’a pas clairement dénoncé. Certes, il souligne encore, en imaginant un nouveau montage « Koulechov », que ce n’est pas exactement le montage qui est « interdit », que c’est l’esprit du plan-séquence dont il faut s’inspirer, mais les ambiguïtés l’emportent et, surtout, pour ce qui nous concerne, la métaphore est toujours placée du côté du montage-roi, de cette mauvaise part du montage qui resterait attachée au cinéma « muet », qu’il ne semble pas possible à Bazin de dialectiser, de « sauver », à la différence de cette autre partie observée chez Stroheim et Murnau dont le « parlant » accomplirait les promesses. Les lions du Potemkine sont alors cités, comme le feu d’artifice que l’on voit dans La Ligne Générale, pendant l’accouplement du taureau : c’est Eisenstein qui fournit les principaux exemples de l’usage « de la comparaison ou de la métaphore » au cinéma, du « montage attraction », quand on ne montre pas l’événement mais qu’on y fait seulement « allusion », quand « le sens n’est pas dans l’image » mais seulement une « ombre projetée » de celle-ci par le montage. Le schéma est insistant et nous rappelle celui de la rhétorique classique : la première période du cinéma témoignerait d’une conception erronée du cinéma où l’image compterait « pour ce qu’elle ajoute à la réalité », comme ornement, et non comme chez E. von Stroheim, F. M. Murnau et R. Flaherty, ou même Dreyer, « pour ce qu’elle en révèle ».392 D’ailleurs, Bazin a opposé dès le début le montage « invisible » du cinéma américain d’avant-guerre, dont la fragmentation a pour but « d’analyser l’événement selon la logique matérielle ou dramatique de la scène » au cinéma de montage de Griffith, de Gance et surtout d’Eisenstein qui crée une signification nouvelle : on retrouve presque l’opposition d’Albert Henry entre le fonctionnement analytique de la métonymie et celui synthétique de la métaphore. Il y a d’un côté un montage qui analyse le réel, qui pour Bazin est parfois conçu comme une absence de montage, et de l’autre une « conception synthétique du montage que le cinéma soviétique poussera à ses dernières conséquences ».393 L’idée d’une manipulation, en particulier à des fins de propagande, est même suggérée avec insistance, notamment à travers les aires géographiques considérées, comme à la fin de la première partie de l’article : c’est « le cinéma soviétique » qui a doté le cinéma de montage de tout son « arsenal de procédés » et « l’école allemande » qui « a fait subir à la plastique de l’image (décor et éclairage) toutes les violences possibles ». En face de ces pays totalitaires, « que ce soit en France, en Suède ou en Amérique », on ne manque pas de moyens pour exprimer ses idées, mais les armes sont tout autres : la cinématographie du monde libre diffère par le fond comme par la forme. Le sens serait imposé d’un côté, révélé de l’autre. À idéologies et procédés fascistes ou communistes répondraient une éthique et une esthétique humanistes, voire une démarche spirituelle