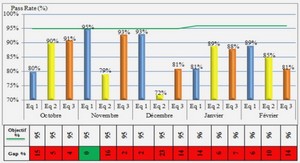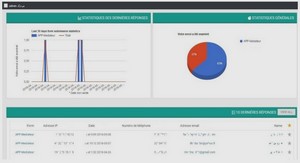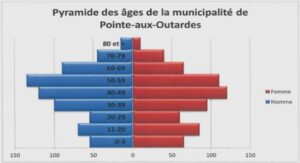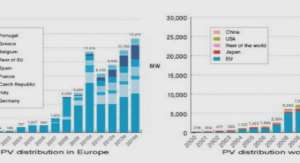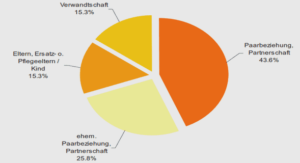LA MORT TISSE
Tu avais pourtant pris l’habitude de ses menaces sorties du fond de la nuit. Des moments d’égarement, de folie : « Je vais me poster dans la rue, devant l’impasse, face aux passants ! » Que voulait-elle ? – T’alarmer, te faire enrager ? Elle avait déjà un enfant, une petite fille charmante, espiègle, faite à la va-vite, à la vanvole, deux ans plutôt. Muriel. De cela, tu ne t’étais pas offusqué, au contraire. Il aurait fallu davantage pour t’effaroucher. Et tu l’avais épousée, te chargeant de tout : la mère et l’enfant. Tu ne manquais pas d’audace, alors ! Que savais-tu, précisément, sur l’auteur de ce petit crime, le père de Muriel ? – qu’il s’était esquivé, l’erreur commise ; qu’il boitait comme Byron, comme boitent les séducteurs ; qu’il étudiait avec passion la psychanalyse. Tu n’ignorais rien de lui, même pas ses préférences secrètes : qu’il dédaignait la pose du missionnaire ; qu’il préférait le dessous. C’était ridicule, ridicule ! Tu pouvais à bon compte faire le supérieur, reconnaître Muriel, le fruit du péché, lui donner ton nom, l’adopter comme ton propre enfant. La procédure était des plus simples : il suffisait en somme de grimper des escaliers poussiéreux, de traverser des couloirs puant l’encaustique, de pousser la porte d’un bureau, à la Mairie. Tu te souviens ? c’était celle du cinquième arrondissement, à droite, sur la place du Panthéon. Vous logiez à ce moment au dernier étage d’une maison de la petite rue Toullier, à côté d’une boutique chinoise, au 5 ou au 7, je ne sais plus très bien, au vrai ;
mais on se sentait, là, exactement au cœur de la ville, au centre du monde, du bon côté de la scène, entre sur la bonne rive, entre la Sorbonne pour le présent, et le Panthéon, réservé au futur. On frissonnait de plaisir et de prétention, en arpentant des rues célèbres, et étroites. Et ta grandeur, la voilà : sans oeuvre de chair, tu avais fait de Muriel ton enfant, par un trait de plume. Ce n’était pas plus difficile que cela. Une déclaration au terne employé de l’état civil, qui somnolait, le coude sur son gros registre noir. Bien sûr, Maud t’avait remercié en sortant. Sans toutefois se jeter à ton cou. Un vilain nuage gris flottait dans les cieux, au-dessus du Panthéon. Mais rien, à cette époque, ne réussissait à t’attrister. Tu ne croyais ni à Dieu, ni à diable. Tu avais seulement foi en toi, en ton destin. Une foi absolue, pauvre Joseph ! Par surcroît, les détonations des bombes au Vietnam t’empêchaient de dormir tranquille. Tu voyais femmes et enfants courir pour échapper au napalm, pendant que des bonzes, froidement, s’arrosaient d’essence, leur torse rigide basculant dans le brasier, la main levée, accusatrice. Pour expliquer ces événements horribles, des analystes savants et stylés avaient inventé une théorie des dominos. Ecole primaire, soldats de plomb : de grands enfants jouaient à la guerre. Or Maud était vietnamienne. Ou presque. Un rêve dont tu ne revenais pas : sous ton oeil apitoyé, dans tes bras généreux, innocents, une Vietnamienne à Paris. T’en souviens-tu, la première fois où tu l’as vue ? A la porte d’une classe de langue orientale, dans un couloir blême d’université, adossées languissamment au mur, formant un groupe,
une grappe étrange, trois ou quatre jeunes filles amalgamées essayaient de vaincre leur timidité, se ressemblant comme des sœurs. Elles ne se parlaient pas, elles s’ennuyaient prodigieusement. On aurait dit qu’elles étaient peintes sur le mur blanc du corridor : une fresque orientale, molle, désuète, imbibée d’une force primitive. Celle que tu as remarquée la première n’était pas Maud mais une autre, qui aurait pu passer pour sa sœur cadette, toute menue, naine et vive, plate et garçonnière, coiffé d’un casque de cheveu dru, .un vigoureux crin noir faisant ressortir davantage la magnificence d’un épiderme couleur soleil aux troubles reflets sombres, orange et moiré de noir. C’est son charme androgyne qui a servi d’amorce pour aiguiller ton regard en direction de ses compagnes d’une beauté plus blanche, plus longiligne, plus féminine. Mais toutes quatre trahissaient cette honte charmante, créant un trouble indéfinissable, une émotion qui saisit aux viscères, ce je ne sais quoi de catastrophique qui ne peut être mieux exprimé que par cette énormité :
la vision de marmots adorables, mais penauds, parce qu’ils ont fait dans leur culotte ; un très ancien souvenir d’école maternelle, déclenchant sans faillir une complicité dans l’embarras, une douce solidarité dans l’humiliation. Et c’est alors que tu l’as aperçue, elle seule : son visage lisse, sans signes distinctifs, impénétrable, insaisissable ; son front buté, son sourire triste, moulé pour le malheur ; des formes plates, mais si bien proportionnées pour qu’elles excitent, agacent, attisent dans l’abstrait, dans le mirage d’un absolu, investies comme elles le sont peut-être d’un mystérieux chiffre d’or qui mesurerait secrètement les rapports mutuels, la longueur comparée des bras, des mains, des jambes, modérant, contrôlant l’épaisseur du buste et du fessier. Une beauté cachée, toute de réserve. Elle n’avait vraiment rien de remarquable, sauf sa timidité, son ennui, son retrait. Son mystère, en un mot. Et cet effacement t’a aimanté. Cette femme d’apparence fragile qui semblait glisser, se cacher entre deux parenthèses de l’existence, c’est elle que tu as élue entre toutes. Tu n’aurais pu mieux choisir, étourdi, fanfaron ! Une mère. Encore presque vierge. L’abstraction allumait ton feu, farceur ! Une Eurasienne, qui pis est. Sacré Joseph ! Un être vague, fantomatique. Une pauvre existence indécise, flottant entre deux eaux.